micro hors-série spécial "le club des policiers yiddish"
(entre les pages 314 et 530)
*
Les serveuses sont connues pour leur retour d'âge, leur mauvais caractère, et un air de famille avec les cabines des semi-remorques.
*
Pendant l'année de malheur qui avait précédé sa défection et sa reddition au côté juif de sa nature, avant que sa mère soit écrasée par un camion fou rempli de juifs déchaînés, le jeune Johnny Bear avait découvert le basket et Wilfred Dick, alors arbitre de 1,27 mètre. Ce fut la haine au premier coup d'oeil, le genre de grande haine romantique qui, chez les garçons de treize ans, est indiscernable de l'amour ou le plus près qu'ils puissent s'en approcher.
*
Landsman reconnaît l'hébreu à l'oreille. mais l'hébreu qu'il a appris porte la marque de la tradition, c'est celui que ses ancêtres ont emporté avec eux pendant les millénaires de leur exil européen, huileux et salé tel un filet de poisson fumé pour conservation, avec une chair au fort parfum de yiddish.
*
Retour au village de Jims : une rangée de toitures métalliques autour d'une crique, des habitations entassées pêle-mêle comme les dix dernières boites de haricots sur une étagère d'épicerie avant l'arrivée du cyclone. Des chiens des gamins et des paniers de basket. Un vieux plateau recouvert de mauvaises herbes et de branches épineuses de myrtilles, une chimère de camion et de feuillage.
*
Hertz bouscule Landsman en exhalant une haleine parfumée à l'eau-de-vie de prune, avec un relent de hareng à l'huile si fort qu'on en sent même les arêtes.
*
Les assiettes sont en fer-blanc émaillé, les verres en plastique, tandis que les couteaux ont des manches en os et des lames effrayantes, le genre d'ustensile qu'on utilise pour détacher le foie encore palpitant de l'abdomen d'un ours.
*
Pendant qu'il contemple le saladier de boulettes d'élan, son estomac émet un gargouillis de lassitude, un son yiddish, à mi-chemin entre un renvoi et une lamentation.
*
Sur la table de cuisine à côté de lui, la baisse de niveau d'une bouteille de slivovitz mesure à la façon d'un baromètre la dépression de son atmosphère personnelle.
*
Quel ton ? riposte Berko, la voix chargée d'une demi-douzaine de tons, pareille à une mesure de partition musicale, un ensemble de chambre d'insolence, de ressentiment, de sarcasme, de provocation, d'innocence et de surprise. Mais quel ton ?
*
Litvak se déshabilla et accrocha ses vêtements à deux patères d'acier. il sentait déjà la marée montante des bains, une odeur de chlore et d'aisselles aux relents salés, qui, à la réflexion, venaient peut-être de l'usine de saumure du rez-de-chaussée.
*
Il passa la langue dans les zones vides de sa bouche, avec leur consistance de mastic gras. Il était habitué à la souffrance et à la casse, mais, depuis l'accident, son corps ne semblait plus lui appartenir. C'était un ensemble de pièces rapportées clouées les unes aux autres. Une maison d'oiseaux, confectionnée avec des chutes de bois et accrochée à un poteau, où son âme battait des ailes telle une chauve-souris affolée. Il était né, comme tout Juif, dans le mauvais monde, le mauvais pays, au mauvais moment, et maintenant il vivait aussi dans le mauvais corps.
*
- Alter Litvak je présume, articula-t-il en tendant la main à Litvak avec un froncement de sourcils, affectant une dureté virile d'une manière qui parodiait et la dureté et la virilté, ainsi que son propre manque relatif de ces deux qualités.
*
Par équipes de deux, six hommes aux surnoms pittoresques de marins perdus dans un vieux film de sous-marins se relaient dans la salle toutes les quatre heures. L'un est un Noir, un deuxième un Latino, et les autres sont des géants roses aux gestes coulants et aux cheveux ras, occupant le créneau entre astronaute et chef-scout pédophile.
*
Landsman prend une nouvelle gorgée d'eau minérale. elle est tiède, avec un goût de fond de poche de cardigan.
*
Lansman considère les choses qu'il lui reste à perdre : une galette avachie en forme de chapeau, un jeu d'échecs de poche et la photo polaroïd d'un messie mort. Une carte des frontières de Sitka, profane, ad hoc, encyclopédique ; des ronces d'aronia, des gargotes et des lieux du crime imprimés dans les circonvolutions de son cerveau. Un brouillard hivernal qui ouate le coeur, des après-midi d'été qui s'étirent sans fin à la manière des arguties des Juifs. Des fantômes de la Russie impériale retrouvés dans l'oignon de la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, et d'autres de Varsovie réveillés dans le bercement et le raclement d'un violoniste de café. Des canaux, des bateaux de pêche, des îles, des chiens errants, des conserveries, des restaurants de laiterie. La marquise de néon du Théâtre Baranof reflétée sur l'asphalte humide, des couleurs qui dégoulinent comme des aquarelles pendant qu'on sort d'une projection du Coeur des ténèbres d'Orson Welles à laquelle on vient d'assister pour la troisième fois avec la fille de ses rêves à son bras.
*
Son pouls rapide, sa bouche sèche et son système neurovégétatif sont prisonniers de l'exaspérante routine de sa phobie, mais le poste à galène qui est distribué à chaque Juif pour capter les messages du Messie vibre à la vue de la croupe de Bina, de sa longue courbe galbée comme une sorte de lettre d'alphabet magique, de rune dotée du pouvoir de repousser la dalle de pierre sous laquelle il a enseveli son désir pour elle.
*
Alors pourquoi son coeur cogne-t-il contre les barreaux de sa cage thoracique comme le quart métallique d'un récidiviste ? Pourquoi le lit parfumé de Bina lui fait-il l'effet d'une chaussette humide, d'un caleçon qui remonte ou d'un costume de laine par un après-midi torride ?
*
Landsman s'écroule sur une banquette dont les coussins couleur ecchymose dégagent un fort remugle alaskéen de tabac froid, mêlé d'une complexe odeur de sel, mi-mer démontée, mi-sueur imprégnant la doublure d'un feutre mou en laine.
*



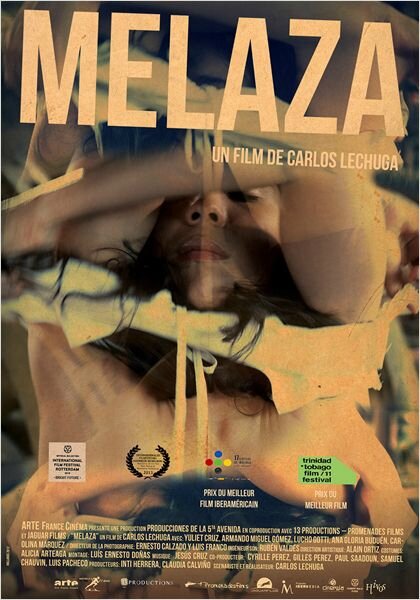




















/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)