rohmervaudage
CAPRICE
d'Emmanuel Mouret
Dans le bôô cinéma, on a déjà programmé pratiquement tous ses films, sauf, bizarrement, l'avant-dernier* (avec JoeyStarr, où il avait pris un ton plus grave), mais, Mouret, c'est comme ça qu'on l'aime, en éternel grand benêt maladroit, aussi emprunté dans ses gestes qu'embrouillé dans ses sentiments. Et des jolies filles dans chacun de ses films. Virginie Efira et Anaïs Demoustier dans celui-ci , mais, auparavant, Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Frédérique Bel, Déborah François, Julie Gayet ont eu avec lui des histoires d'amour. L'amour chez Mouret n'est pas très loin de celui de chez Perceval le Gallois, par exemple. Les mots "carte du tendre", "amour courtois", "horriblement compliqué" sont tout à fait de mise. On pourrait même rajouter au cocktail un zeste de Roro Barthes pour le faire un peu plus effervescer. Comment théoriser la pratique (et donc pratiquer la théorie). Non, rien n'est jamais simple dans les histoires d'amour d'Emmanuel M. Pourrait presque l'être, mais ce serait trop facile. Et ce qui pourrait être facile le dédevient, automatiquement. Parce qu'on "pense"...
Ce qu'on aime, en tant que spectateur, c'est guetter l'apparition du grain de sable qui va immanquablement venir enrayer la machine, et, surtout, de quelle façon il va le faire. Et quelquefois c'est encore un peu plus compliqué, il y a deux grains de sable, et on hésite, on tergiverse, on suppute, lequel serait donc le plus apte à bousiller le mieux le processus, chacun de son côté, à moins que les deux... Comme il y a une mécanique du rire, une mécanique des femmes, il y a une mécanique des films de Mouret.
Une cérébralité certaine, qui s'appuie sur des dialogues très précisément écrits, presque précieux (de précis à précieux il n'y a qu'un eux d'écart). Il y a relation amoureuse, certes, mais il y a surtout un questionnement (mille questionnements) à propos du processus en question, qu'on se pose à soi-même, qu'on pose à l'autre, et aux autres aussi. Et chacun de mettre son grain de sel (ou de sable). Un comique de geste, aussi, un comique de maladresse et de gaffe (entre Tati et Pierre Richard), et, encore plus léger, un comique galant de l'incertitude, de l'entre deux, du oui ou non...
Comme si on essayait de résumer l'amour par une formule mathématique, ou une recette de cuisine. Quels ingrédients, dans quelles proportions, quelles actions, dans quel ordre... On ne sait jamais, on n'est jamais sûr, alors on joue à "et si..." (ça pourrait être tout aussi bien le jeu du petit chimiste).
Là, Mouret est divorcé, son ex-femme est très gentille parce qu'ell est partie avec son meilleur ami et donc qu'elle culpabilise. Le voilà qui rencontre une actrice de théâtre qu'il idolâtre (Virginie Efira, blondissime, avec des chaussures dorées sublimes -tiens, voilà que je vire Bunuel...-) et se met en ménage avec elle. Bonheur total, nirvana, plénitude, sauf qu'une rousse piquante (Anaïs Demoustier) lui tourne obstinément autour, autour de son jeune couple, de son bonheur tout neuf, de sa fidélité consciencieuse... Ah et il y a aussi son directeur (Laurent Stocker)- j'ai oublié de dire qu'Emmanuel M était instit'- que sa femme vient d'abandonner et qui aimerait bien en retrouver une autre...
Les quatre danseurs sont en place pour le quadrille, et, bien sûr, la musique commence... "Faites la révérence, tournez, échangez vos cavalières..." (je ne raconterai rien de plus) Zabetta a dit qu'elle s'y était un peu ennuyée, moi, non non, rien que le fait de voir les petites mines d'Emmanuel Mouret me titille les commissures, alors je suis prêt à être plein d'indulgence. J'ai ri, j'ai souri, j'ai même pouffé (pas trop fort, parce que dans la salle, les autres spectatrices -il n'y avait que des femmes!- se cantonnaient dans un silence recueilli. (étaient-elles, elles aussi, amoureuses d'Emmanuel M. ?)
Il me semble qu'il y a, sur tout cet apparemment volatil marivaudage, un petit quelque chose de moins souriant, un léger voile d'amertume (ou d'aigre-douceur) qui n'existait pas forcément dans les oeuvres précédentes (mais j'ai pu oublier), et je trouve plutôt plaisante cette voix-off teintée d'un zeste de tristounerie qui ouvre et clôt le film (les paroles s'envolent...).
Oui, plaisant. "Mentir, ça peut être intéressant..."
* (On me fait remarquer (merci Philou) que ce film est passé dans le bôô cinéma, et que c'est même nous (j'ai vérifié) qui l'y avons programmé... Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas vu un film qu'il n'a pas été programmé... J'ai eu tort, et je le reconnais publiquement)






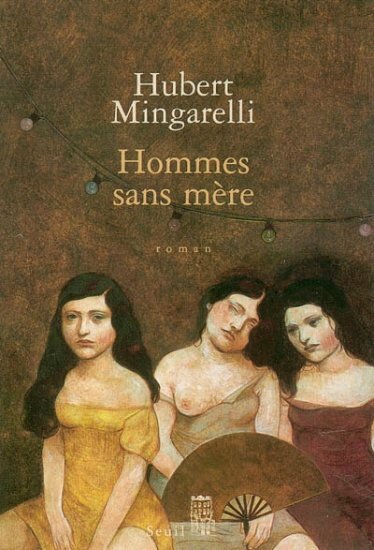



/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)