I am very photogenic
136
FRANKIE
de Ira Sachs
Comme l'a résumé plus tard par mail le projectionniste-chef du bôô cinéma "ce film franco portugais, est finalement en version anglaise sous tirée en français....................." (je recopie tel que). Je suis donc allé le voir en VO à Besac, puisqu'il était annoncé en VF dans le bôô cinéma (alors que finalement non).
La star est française (isabelle Huppert, huppertissime, dans un rôle sur mesure), le réalisateur est américain (Ira Sachs, dont on a ici programmé et aimé plusieurs films déjà, Brooklyn Village, Love is strange, et que je n'imaginais pas s'aventurer un jour hors de son pré carré new-yorkais), le décor est portugais (Sintra et ses environs), et la distribution cosmopolite (américano-franco-portugaise). Une star de cinéma (qui va bientôt mourir, on l'apprendra progressivement) a convié sa "famille" -au sens large- (son mari, son ex-mari, son fils, sa fille (enfin, celle de son mari), qui est venue avec son mari et sa fille à elle, une amie actrice américaine qui est venue avec un ami avec qui elle a bossé sur Starwars), pour un genre de réunion familiale (avec un je ne sais quoi de tchékhovien) qui va être pour le réalisateur l'occasion de faire le point sur la notion de "couple". Le film nous en présente un certain nombre : "vieux" couples (un qui a duré, l'autre pas), et jeunes couples (couple d'ados, couple de jeunes gens), couple qui commence et va peut-être durer, couple qui va mourir au bout d'un certain temps, couple qui meurt à peine il est né, couples hétéros et gay (un,mais hors-champ, seulement évoqué) bref couples couples couples...
Avec, au centre de ces duos/duels, l'impériale Isabelle. Qui interprète Françoise Crémont (dite Frankie), une famous french actress (un personnage qu'on pourrait supposer pas très loin de celui, justement, d'Isabelle Huppert, famous french actress) qui, un peu comme chez La Fontaine
("Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins")
a, semble-t-il, une idée derrière la tête en organisant cette aimable excursion lusitanienne et familiale... Etant habituée à ce que tout le monde soit à sa disposition, il lui semble logique, à ce moment-là de sa vie, d'en prendre, justement (des dispositions). Sans que forcément les gens concernés soient toujours d'accord avec elle (ni elle avec eux, d'ailleurs)
Une très bonne idée du réalisateur est de lui avoir donné pour mari (le deuxième, celui avec qui elle est toujours) l'impressionnant -physiquement- Brendan Gleeson, un acteur irlandais précédemment par moi très apprécié dans des films assez éloignés de Frankie : que ce soit dans Bons baisers de Bruges (de Martin Mc Donagh) ou encore L'Irlandais ou Calvary de John Michael Mc Donagh (dont je suis prêt à parier qu'ils sont frères et irlandais), dans des rôles de tueur, de flic ou de prêtre, il promène à chaque fois une présence massive et bourrue, un genre de quintessence virile et irlandaise, qui le rend profodément attachant, tandis qu'ici il change complètement de registre en incarnant un personnage tout en retenue, dans un rôle de mari amoureux qui souffre en silence...
Huppert est -comme d'hab'- magnifique, plus ça va et plus elle affine et épure (minimise) son non-jeu (dès la toute première scène, quand elle arrive au bord de la piscine, on est subjugué par la façon dont elle compose -incarne- son personnage en donnant le sentiment de ne rien jouer, ou presque, et c'en est sidérant). Elle est accompagné par une galerie d'acteurs et trices tout à fait au diapason : Brendan Gleeson, déjà nommé, Pascal Greggory (le premier mari), Jérémie Rénier (le fils), Vinette Robinson (la fille), Marisa Tomei (l'amie), qui lui renvoient la balle (ou se la renvoient aussi entre eux) puisque le film serait un peu une série d'échanges, (comme par permutations) souvent à deux, quelquefois à plus, où le réalisateur semble poser sa loupe sur les micro-événements qui se jouent alors. L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, titrait Jean-Daniel Pollet que j'ai déjà ici maintes fois cité, mais j'aime cette formule qui, dans sa simplicité touche (bien sûr) à l'universalité. Surtout dans l'optique Rohmer /Allen (on pourrait rêver plus mauvais parrains) que semble avoir choisi le réalisateur.
C'est très bien joué, les paysages sont magnifiques, la lumière au petit poil, et pourtant on ne peut pas s'empêcher, rétrospectivement de trouver tout ça un peu lisse. (Alors qu'on a conscience de prendre un grand plaisir de spectateur). Formel ? A l'image de cette dernière séquence à la fin du jour où tous les personnages se retrouvent sur la plage, autour de Frankie, et où la caméra s'éloigne pour les voir s'en aller et sortir du champ (de la narration) l'un après l'autre, jusqu'au dernier (on s'est posé la question avec Emma et on s'est mis d'accord, il semblerait que ce soit le jeune -et mimi- guide portugais). La scène alors reste vide un moment, j'ai chuchoté "Et... Coupez!", encore deux secondes, et effectivement, ça a coupé. Générique.





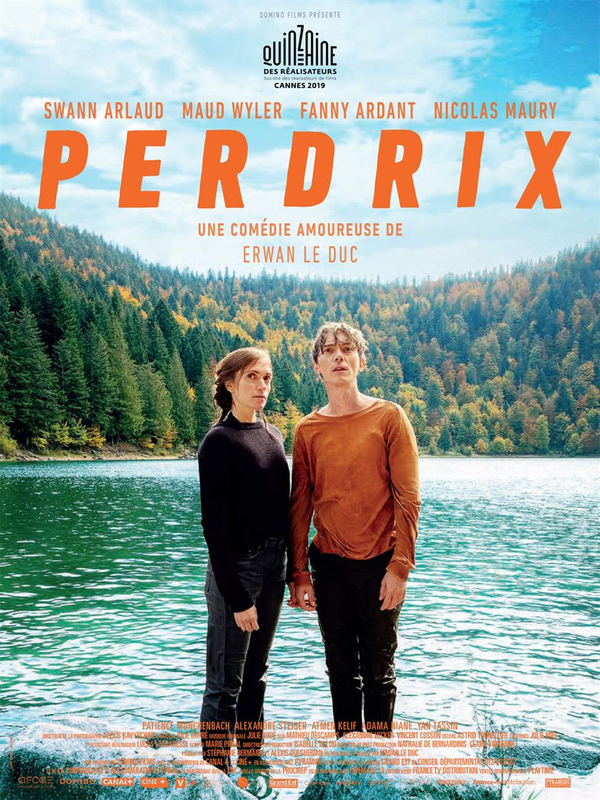








/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)