de bruit et de fureur
LA TÊTE HAUTE
d'Emmanuelle Bercot
Un ado tête à claques sujet à des accès de violence et ses rapports fusionnels avec sa mère immature, tiens tiens on a déjà eu ça l'année dernière, non ?, avec Mommy de X. Dolan (que j'ai mis du temps à voir mais que j'ai vu quand même.) Là j'ai préféré y aller le plus tôt possible pour que la même chose ne se reproduise pas. Des inconvénients de la surmédiatisation. Le film d'Emmanuelle Bercot (dont j'ai adoré le Elle s'en va, même si vu très tardivement) vient d'en faire les frais. Parce qu'il faisait l'ouverture du Festiwal de Cccânnes, parce que Catherine Deneuve, parce que jeune prodige, parce que choix audacieux pour ce genre de film en ouverture parce que parce etc.
C'est quoi ce "genre de film" ? L'histoire d'un gamin de 7 à 17 ans, un gamin qui est "mal parti dans la vie" (dès la première scène), et qui va affronter successivement les acronymes de tous les services sociaux, juridiques, pénaux, éducatifs, ou presque, grâce à l'entêtement d'une juge pour enfants maternelle et et compréhensive (Catherine Deneuve, qui a fait quelque chose à ses sourcils) et d'un éducateur aussi cabossé (là je ne pouvais pas échapper à cet épithète) qu'entêté (Benoît Magimel, les cheveux en pétard), qui veulent toujours continuer à espérer, sans fin, avec obstination, au fil des ans, et pourtant il y aurait largement de quoi baisser les bras et lâcher l'affaire. La mère immature est (un peu sur-)jouée par Sara Forestier, et le jeune homme souvent énervé par Rod Paradot, dont c'est le premier rôle et qui est effectivement phénoménal. Tout le monde l'a dit et s'en est extasié, mais c'est vrai. Vraiment vrai. Que ce soit lors de ses accès récurrents de violence (qui surviennent à un rythme quasi métronomique), lors des moments "normaux" ou ceux de calme (ou d'abandon) il est d'une justesse et d'une force qui laissent admiratif.
Un survol des différentes mesures de prévention, de suivi, et de (punition ?), centré autour d'un jeune homme très énervant (autant que très attachant). Heureusement, on ne joue pas exactement sur le même terrain que Mommy (là, en gros, la mère et le fils ne se voient que dans le bureau de la Juge ou ceux des instances socio-éducatives -ou pénitentiaires-). Mais tous les deux restent toujours en contact, tant le lien qui les unit est fort (on dirait un film écrit par un éducateur, quand même, non ?), et même "trop" fort (plus ça va et plus la réalisatrice insiste là-dessus). Je connais peu les juges pour enfants, alors je me garderai bien de juger, mais, hmmm, toute cette compassion, cet attachement, ça n'est quand même pas un peu roudoudou et chamallow ? C'est en cela que tout ça m'a quand même un peu gêné (avec en plus comme dit Marie, "un peu l'impression d'être au boulot", tellement certains de ces acronymes (AEMO, notamment) tintaient réalistement à mes oreilles.) Et que le clou est bien bien enfoncé, que le concept de "famille" ou de foyer est visiblement importantissime aux yeux de chacun (et semble rester la panacée, cf le passage de relais final qui me paraît tout de même un peu honteusement crapoteux).
Contrairement à Polisse (dont elle a co-écrit le scénario et dans lequel elle jouait) où la nécessité d'un "regard extérieur" (celui, doublement, de Maïwenn, en tant que personnage et en tant que réalisatrice) permettait justement de prendre une imperceptible distance par rapport aux choses parfois effroyables du récit ("Oui, c'est du cinéma"), Emmanuelle Bercot se focalise ici juste sur Malony, et son environnement proche, sur cet unique (j'avais écrit inique) parcours, mais de très près, comme vu de l'intérieur. Sans filtre. Apparemment sans recul ni enjolivures ni effets de matière filmique. Brut. Les faits, les décisions de justice, les placements. Rien que. Et un gamin qui tente de s'en démerder (pas de s'en sortir ou de s'y insérer, il nous est montré à plusieurs reprises comme suffisamment intelligent et roublard pour être -un certain temps- capable de "jouer le jeu", d'être conforme à l'image qu'on attend de lui, d'être acteur -la réalisatrice le fait même s'en vanter ouvertement "je suis un bon acteur..."-) Cinéma social, humain (humaniste ?). Ok. Mais il y a quand même un contraste, un hiatus, un effet de friction, entre le parti-pris du film, ses intentions, et, par exemple, la présence -très forte- de Catherine Deneuve, le battage médiatique, la montée des marches, etc.
Pour parler franchement, ce cinéma-là n'est pas celui qui me convient. L'angle "sociétal", humanitaire, la bonne conscience, la curiosité (oh que ces pauvres sont pittoresques, diantre que ces manants ont de drôles de manières, ciel qu'ils s'expriment de blasphématoire façon) pourraient presque virer malsain, voire obscène. La composition de Sara Forestier irait d'ailleurs dans ce sens. Rosetta, le film, de la même façon, ne m'avait pas convaincu (et pourtant, elle avait, elle (le personnage), à la fois un background et un but qui justifiaient son attitude, et légitimaient la façon de la filmer. Notre Rosetton, là, est moins bien servi scénaristiquement, juste comme un instamatic mental (deux positions : soleil et nuage) et, si le personnage devient à la longue moins intéressant, le jeune acteur qui l'incarne est, je le répète, toujours passionnant.











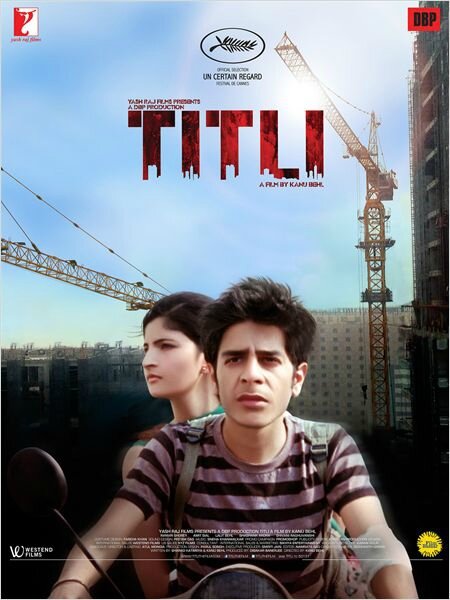



/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)