lobby boy
THE GRAND BUDAPEST HOTEL
de Wes Anderson
Je sortais donc de Week-ends, que j'avais plutôt beaucoup aimé, et je suis donc entré dans la salle, un peu inquiet : ce film-là allait-il tenir les promesses, à la fois générées par le bonheur éprouvé au précédent Moonrise kingdom, et l'unanimité des échos de ceux/celles qui l'avaient déjà vu ?
Et hop! ça a démarré, et hop! j'ai retrouvé instantanément cette sensation d'extrême plaisir, qui ne m'a absolument plus quitté jusqu'à la toute fin du film!
Je place Wes Anderson plutôt très haut dans ma cinéphilie personnelle, mais je dois dire que c'est venu très progressivement, marche par marche, au fur et à mesure que je voyais -et revoyais- ses films (qui, au tout début, ne m'avaient pas plus intéressé que ça...) les uns après les autres, et que j'y trouvais de plus en plus mon compte, peut-être encore davantage, d'ailleurs, dans la façon de filmer que dans l'histoire ou les personnages.
Il est indéniable qu'il y a désormais une "patte" Anderson, un univers personnel, dans cette façon de voir -et de montrer- millimétrée, mais si joyeusement foldingue -frivole ? - en apparence, dans ces agencements de couleurs, ces mouvements d'appareil géométriques, ces cadrages à tomber, ces dialogues hyper trop bien écrits, ces références à la bande-dessinée, cet humour, cette utilisation gourmande de la musique, cette richesse, cette générosité... Ce Grand Budapest Hôtel, je l'ai savouré in extenso, d'un bout à l'autre sans défaillir (j'allais écrire "sans débander", c'est vous dire si j'étais joyeux!).
Il s'agit d'un film -et d'une histoire- "multi-couches", on part de notre époque, pour à travers le récit d'un des protagonistes, remonter en arrière, puis, dans ce nouveau récit, faire encore un saut dans le temps, jusqu'aux années trente et quelques. Il est question d'un hôtel bien sûr, de son propriétaire, de son concierge ("Monsieur Gustave") et de son grouillot (son "lobby-boy", Zero), de différents clients (clientes, plutôt, en majorité, des vieilles richissimes avec qui le sieur Gustave noue les plus tendres liens) jusqu'à ce qu'une de ces vieilles excentriques, justement, décède, et que l'ouverture de son testament coincide avec celle des hostilités.
Un meurtre, un tableau volé, un cuisinier français disparu, un policier entêté, un tueur buté et impitoyable, vont ainsi se courser et joyeusement court-circuiter, dans une farandole à la fois très graphique, délicieusement drôle, et au sous-texte moins léger, puisqu'il ne s'agit rien moins que du début de la nouvelle guerre. (On est légèrement surpris d'apprendre, au début du générique de fin, que le film doit beaucoup à Stefan Zweig, que le réalisateur remercie publiquement.)
On peut, en plus des péripéties diverses et cocasses qui s'enchaînent à un rythme riens moins que soutenu, s'amuser à reconnaître, sous leurs déguisements divers, les différents acteurs (et la liste est fort longue, qui défile au générique de fin!) qu'on identifie plus ou moins d'ailleurs (heureusement qu'on sait qu'il s'agit de Tilda Swinton, par exemple).
Le rythme est alerte, la musique aussi, qui fait merveilleusement corps avec l'action (Alexandre Desplats a encore une fois fait un excellent job)
Un grand grand bonheur de cinéma, voilà. un film gourmand, qui appelle, avec un sourire en coin, à en reprendre un petit morceau... (tss,en ce moment, je ne vois que des excellents films!)







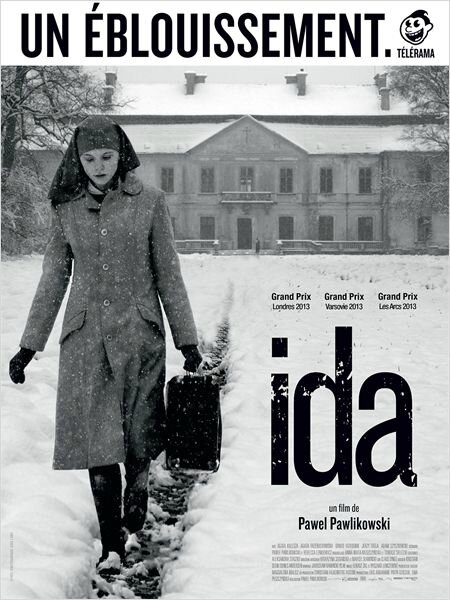


/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)