LEVIATHAN
de Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel
C'est rare que pour apprécier pleinement un film je décide de m'installer bien au milieu de la salle ("au croisement des diagonales") pour en jouir pleinement, la dernière fois, c'était pour le sublime NE CHANGE RIEN de Pedro Costa. Les réalisateurs (oui, un monsieur et une dame, ça donne "les réalisateurs") de Léviathan annonçant une "expérience sensorielle ultime", et Hervé, en amont, étant tout aussi enthousiaste, je me suis dit que ça en valait peut-être la peine...
Wouahhhhh! En effet, ça la valait bien (la peine). Nous voilà sur un bateau de pêche, (si on ne le sait pas, on met un certain temps à le deviner, tant les premières images sont déroutantes, et nous forcent à quitter nos repères habituels) embarqués, le mot est juste, en pleine mer, avec les pêcheurs, les mouettes, les poissons, le tangage, le roulis, les écoutilles, les mouettes, dessus dessous, dehors, dedans, la nuit, la tempête, les éléments déchaînés, on vit ça véritablement du dedans, au plus près, en plein coeur.
On a l'impression qu'au tournage il y avait des caméras partout, sur le bateau mais dans l'eau, sur le pont, dans la cale, et même sur la tête des pêcheurs. Une matière intense, colorée, violente, accidentée (et probablement parfois accidentelle aussi), paroxystique, triturée et mise à vif, à nu, par un montage ad hoc (montagnes russes, rythme aléatoire, déstabilisant, où l'on peut aussi bien alterner violemment les images les couleurs les textures, empiler, hacher recoller, que soudain tout poser (comme au fond de l'eau se déposeraient les sédiments) pour un soudain plan long -on peut alors parfois penser "trop long"-, calme ou moins, en forme de respiration,break), avant de repartir ailleurs, un nouvel ailleurs incertain, glissant, fuyant, mouillé, encore renforcé par le travail sidérant effectué sur le montage-son, qui vous immerge véritablement dans un caisson aquatique, parfois amniotique, le plus souvent maelstrom, machineries, bruitages mi-organiques mi-industriels, aqueux, comme s'il s'était agi de reconstituer l'essence même du travail des pêcheurs.
Parlons-en, de ces pêcheurs . Ici devrait forcément apparaître le mot "rugueux", tel qu'il est apparu souvent dans les critiques du film, et qui apparaît tout aussi régulièrement dès qu'on montre des hommes dont ni les conditions de vie ni l'apparence physique ne correspondent tout à fait à l'habituelle imagerie mâle cinématographique ambiante, lisse proprette inodore. Et qui serait ici tout particulièrement adapté, puisque le caractère du rugueux est, spécifiquement, de ne pas être lisse, de présenter des irrégularités, des aspérités, qui justement permettent de faire face au mouvant, au glissant, à l'aquatique, au maritime. Schématiquement, le rugueux du marin serait le velcro qui lui permet de ne pas glisser sur le pont, et c'est tant mieux. Je plaisante, mais à-demi. Les hommes dans Léviathan sont montrés avec la même proximité, la même intensité, la même curiosité que leurs confrères marins, à nageoires, à branchies ou à coquilles. Avec la même fascination, d'égal à égal. Qu'ils soient en pleine action (vacarme, paquets de mer, agitation, exécution, ou au repos -étonnante séquence à la fois étirée et resserrée dans le temps d'un marin qui s'endort dans la cambuse en regardant les infos à la télé, son mug de café à la main-...).
Vu juste avant le film des Coen, je ne savais pas encore que j'allais voir deux films grandioses coup sur coup.
Dommage que le film, programmé juste deux fois au bôô cinéma dans le cadre du mois du doc, ait attiré si peu de monde (on était 5 au début, et 4 à la fin, enfin, déjà juste au bout de dix minutes...) et re-dommage que, dans ce même bôô cinéma, on ait la détestable habitude de rallumer -cling!- les lumières de la salle dès les premiers mots du générique de fin (et parfois même avant), sauf que, dans Léviathan, le film continue après ledit générique de fin, quelques minutes dans le noir, avec juste une lumière qui s'éloigne et sur un dernier glougloutis... du coup, on a juste entendu le glougloutis... Pfff!





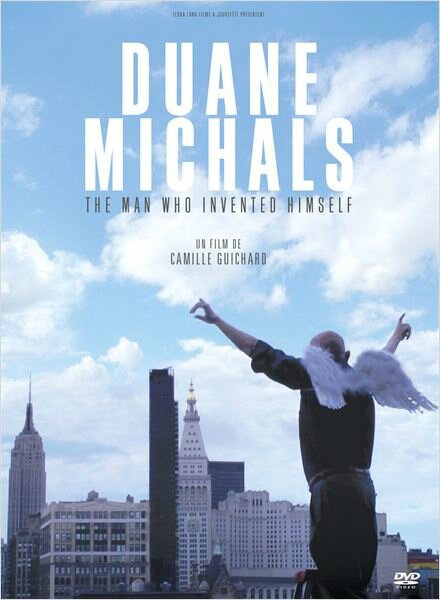







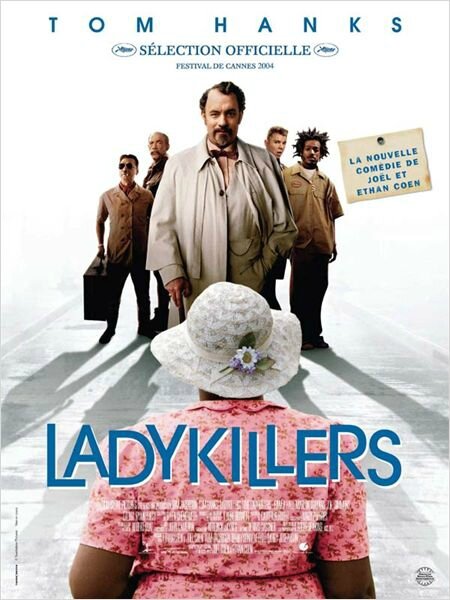







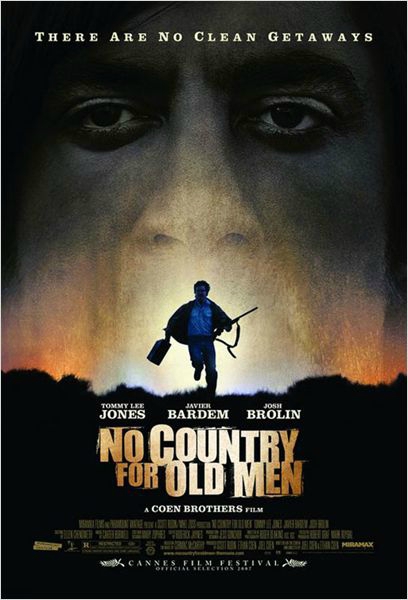





/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)