"children..."
MEDEE
d'Euripide
Mise en scène de Laurent Fréchuret
Réalisé assez rapidement que cette pièce n'est, finalement, que la suite de Jason et les argonautes, présenté il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'Ecole et cinéma.
Réalisé aussi que le personnage en est beaucoup moins kitscho que l'actrice sixties (j'ai oublié son nom) qui l'incarnait dans le susdit Jason. Catherine Guermain, ici, est impressionnante de simplicité (robe rouge, pieds nus, cheveux défaits, longs bras maigres) face à (soyons honnête) celui sur le nom de qui j'étais venu voir la pièce, Jean-Louis Coulloc'h, qui incarne Jason (Un Jason robuste, certes, au physique impressionnant -il finit hmmm la pièce torse nu- mais également un Jason pitoyable, vaniteux, veule, macho, bêta, tout au moins pendant une grande partie de la pièce.)
Le dispositif scénique est clairement pluricul/multimed : sur scène, des musiciens s'accordent (guitare, violon, batterie) , une femme à cheveux roux/ras se maquille (ce sera le Choeur) tandis qu'est projeté format géant sur tout l'espace du fond de scène un film de famille (papa maman les enfants) plutôt joyeux comme savent l'être les films de famille en super-8, derrière le quel une bascule lumière va progressivement nous faire apparaître un Médée prostrée dans une haute maison de bois (j'ai beaucoup aimé cette façon de nous faire passer quasi insensiblement de la salle à la scène sans qu'on sache vraiment à quel moment ça a commencé, on y est tout à coup et c'est tout) tandis que la musique monte et sinue...
Je ne connaissais grosso modo que le noeud de l'intrigue : Médée va employer les grands moyens pour faire le malheur de ceux qui ont voulu la chasser, et, après avoir fait mourir la future jeune épouse de son ex dans d'atroces souffrances grâce à un voile magique apporté par ses enfants (ceux qu'on a vu rigoler avec papa Jason et maman Médée dans le film du début) va égorger ces enfants-là pour que sa vengeance soit complète. Dieu merci tout cela est hors-champ, figuré par le récit (la mort de l'épouse) ou par l'image (la scène précédant la mort des enfants est une belle et impressionnant montée -dans tous les sens du terme- Médée grimpant sans fin les escaliers de bois qui mènent à son crime tandis que la musique -il n'y a plus me semble-t-il à cet instant que la guitare électrique- l'accompagne dans des riffs lancinants et de plus en plus forts. Un grand moment assurément de climax après lequel il ne restera plus grand-chose à dire. La douleur de Jason, qui finit immobile, à mi-hauteur, à l'endroit même ou Médée se tenait au début de la pièce, tandis que cette même Médée vient elle s'installer à la table où se maquillait le Choeur en ce même début, et, se démaquillant, désormais seule en scène dans un pinceau de lumière, lance juste avant le noir final, se détournant de son miroir, un regard au public d'une force extrême.
Laurent Fréchuret m'avait déjà ravi avec son Roi Lear, et continue ici -avec quasiment le même bonheur- son entreprise de "dépoussiérage", ou, en tout cas, de relecture des standards du théâtre, (la traduction du texte est nouvelle) même si, dans le cas présent, j'ai pu être par instants -au moins au début- un poil gêné par cette volonté d'enfoncer un "coin" quasiment comique (le personnage de Jason) dans la bûche de la tragédie pure et dure, comme une fissure, pourtant (assez vite) refermée, le Jason de la fin étant presque un autre personnage.


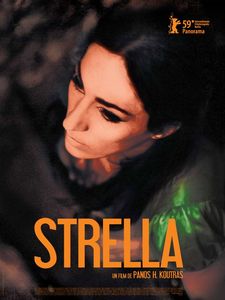
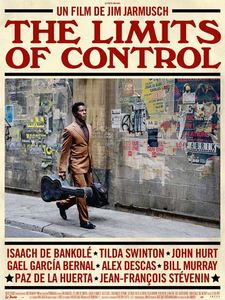


/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)