L'INCONNU DU LAC
d'Alain Guiraudie
Je n'ai jamais manqué aucun film d'Alain Guiraudie, (et, celui-ci, je peux dire que je l'attendais tout particulièrement), et j'y suis donc allé tout de suite, le premier jour à la première séance (100 bornes aller/retour pour deux heures de bonheur). Et, pour une fois, alors que tout le monde est d'accord, eh bien je suis d'accord aussi : le film est merveilleux, oui oui, et c'est certainement le meilleur de Guiraudie. Que dire d'autre ?
Qu'il prend toute sa force (ou qu'il prend encore plus de force) à travers son superbe plan final, ce qu'on appellerait une fin ouverte, mais qui est beaucoup plus que ça...
Si Guiraudie est culotté dans sa façon d'appréhender le cinéma, quasiment à bras-le corps, ses personnages le sont beaucoup moins (bon, c'était facile, mais je ne pouvais pas m'en dispenser), vu que c'est, selon le réalisateur, "tout le monde à poil"! (pour les habitués du blog, c'est un F très AQV).
Décor unique : un lieu de drague homosexuel : une plage, un lac, et des bosquets. Ajoutez un soleil omniprésent et quotidien, et roulez jeunesse (sauf que non, justement, tous les âges sont représentés). Guiraudie, comme moi, aime les monsieurs, mais les monsieurs "normaux", ordinaires, quotidiens, pas les super top models épilés bodybuildés truc machinés. Il les aime tels quels, et donc, il les montre ainsi, tous, les ventrus, les poilus, les débraillés, dans leur plus simple appareil. Et ce, suivant une chronologie (une temporalité) immuable : on arrive en bagnole, on traverse les buissons jusqu'à la plage, on pose sa serviette, éventuellement on salue les copines, on se dépoile, et hop c'est parti pour le farniente (en apparence), alors qu'en réalité il serait plutôt question de chasse. On papote, on mate, on va se reafraîchir un peu, on adimre, on se fait admirer, on désire, on se fait désirer... L'immobilité sur la plage est en général suivie du furetage dans les buissons, à la poursuite d'un regard, d'un corps, d'un instant, d'une jouissance...
Le réalisateur retranscrit tout ça très simplement, naturellement pourrait-on dire (et doublement même, dans les deux sens du mot). Tout sonne réel et juste (c'est peut-être son film le plus "réaliste", depuis le superbe Ce vieux rêve qui bouge.) Parmi tous ces corps exposés, et, a priori (et par définition, dans ce genre de lieu) anonymes, quelques-uns vont pourtant soudain être dotés d'un prénom (et d'une proximité plus grande avec le spectateur) : Franck, Michel, et Henri
Franck est le "héros", le centre du film. Un homme sympathique, joliment normal (bonne tête, quéquette joviale), qui sympathise d'abord avec Henri (un vrai personnage "guiraudien", plus âgé que lui, bedonnant, se présentant comme hétéro (qu'on pourrait qualifier de flexible, comme le roseau du même nom) dans ce haut-lieu de dragouille, qui reste pourtant toujours à l'écart dans son coin et ne prend jamais part au(x) manège(s) des dragueurs), et (je parle de Franck, le premier sujet) va tomber en même temps amoureux de Michel (sorti de l'eau du lac telle la Vénus de Botticcelli), un moustachu bogosse bon nageur, bon baiseur, - dont il déplore d'abord que, comme chaque fois qu'il rencontre un mec qui lui plaît, celui-ci ne soit pas "disponible"- mais qui va rapidement le devenir, puisque, un soir ("entre chien et loup") Franck, caché dans le bois, va assister au meurtre du gênant en question par le joli et sportif Michel (celui dont il est amoureux, vous suivez ?) qui va le noyer sans autre forme de procès, comme dirait La Fontaine. (d'ailleurs, tiens, Le loup et l'agneau, on n'en est finalement pas très loin...) Et hop, ni vu ni connu, la voie est libre!
Et pourtant, après avoir assisté à ce glougloutis crépusculaire, Franck ne dit rien, fait l'autruche (amoureuse) et comme si rien ne s'était passé, et continue ses travaux d'approche, (qui vont rapidement s'avérer plus que fructueux) sous l'oeil à la fois paternel et critique d'Henri... J'ai, ici, adoré le personnage d'Henri, qui représente en même temps le choeur et le deus ex machina, avec cette immobilité, cette parole économe, mais faisant passer énormément de choses sans forcément les dire... (peut-être aussi hin hin m'y suis-je un peu reconnu...).
Car le désir de Franck pour Michel ne semble pas prendre en compte le fait que celui-ci puisse être un meurtrier. Ou, justement, si. Et l'entrée en scène d'un quatrième homme, extérieur à l'histoire (il s'agit d'un flic bonne pâte assez guiraudien) ne va pas simplifier les choses, un peu comme on viendrait agiter l'eau du lac pour tenter d'apercevoi ce mythique et gigantesque silure, et qu'on ne faisait finalement que troubler la vision en remuant la vase...
Oui, mine de rien, dans ce joli catalogue sentimental, il sera question d'amour, d'affection, d'amitié, de désir, de bienveillance, d'attention (d'un côté) mais aussi de désamour, d'inquiétude, de mort et de meurtre (le revers de la médaille). Et le film va lui aussi progressivement se laisser contaminer par cette dualité, cette ambivalence, comme on souffrirait d'une malade de nuit, nous faisant ainsi passer tranquillement (!) du très ensoleillé "Les bronzés dragouillent au bord du lac" au plus crépusculaire "Promenons-nous dans les bois, mais le loup y est encore..."
Et c'est là que la mise en scène de Guiraudie est vraiment virtuose. Sans esbroufe, sans effets de manche, sans musique, sans coups de théâtre, juste avec du temps qui passe, quelques corps qui se rapprochent ou s'éloignent, avec des mots et des sentiments qui hésitent, il nous embobine sans aucune difficulté, et réussit à nous mener par le bout du nez (non non je ne parlerai pas du bout de quoi que ce soit d'autre).
Avec ces journées qui se suivent, où le passage du temps est rythmé par des vues du même parking, avec l'apparente similarité que produit la répétition des mêmes actes, il joue quasiment avec nos nerfs, instaurant des ellipses quasiment narquoises, des bifurcations légères, des répétitions entre le rassurant et le comique, et toujours des points de vue extrêmement travaillés et pourtant donnant une apparence d'extrême simplicité, de facilité presque.
Les hommes, certes, les corps et les sentiments, bien évidemment, mais au sein de cet environnement naturel extrêmement présent (le soleil, l'eau, le vent, les arbres), qui inscrit le film dans une réalité prégnante, enveloppante, essentielle (oh les arbres que le vent bringueballe, oh les nuages, oh l'eau et ses couleurs changeantes, oh les bruits des insectes) qui en fait un peu le quatrième sommet de ce triangle passionnel.
Je n'ai pas du tout ressenti le sentiment de bricolage et de hautement improbable que m'avait laissé Le roi de l'évasion (auquel j'avais, allez savoir pourquoi, du mal à croire, peut-être à cause de l'artificialité de son personnage féminin). Le film est "tenu" et assumé de bout en bout, avec cette coda magistrale qui le hisse soudain au stade de grand film. (alors qu'il n'aurait fallu que peu de chose pour que tout cela ne tombât du côté du grotesque ou du ridicule). Un ou deux critiques ont même évoqué Apichatpongounet, et je ne pourrais pas leur donner tort (sur le coup, j'ai pensé à Philippe Grandrieux, mais les hypothèses se complètent...)
Un dernier point (qui pourra peut-être en surprendre certains) : dans les précédents films de Guiraudie, je me suis toujours ou presque senti un peu frustré parce qu'on n'en voyait "pas assez" ; ici ce serait quasiment l'inverse, j'ai le sentiment -presque- qu'on en voit "trop". Les scènes de sexe non simulées (à cause desquelles le film a été interdit au moins de 16 ans) sont effectivement très chaudes, mais étaient-elles à ce point indispensables ? Finalement je suis assez... puritain (est-ce le mot qui convient ?) en ce qui concerne les QV. Je les préfère "au naturel", joviales et au repos. De la vraie quéquette sympathique qu'on a plaisir à épier comme du coin de l'oeil, mine de rien. A partir du moment où elles sont en érection, ou, encore mieux, en action, on quitte la poésie naturaliste indolente et on entre dans le domaine du film dit "pornographique", et donc beaucoup moins intéressant. Voilà, il fallait que ce fut dit.
Mais ce film a tout pour plaire, d'abord par ce qu'il est (mais ça, c'est une constante chez Guiraudie) aimant, et infiniment respectueux des hommes en général et de leur corps en particulier. Et de leurs sentiments aussi, cela va sans dire. Où il serait juste question de respect et de considération. (Et de lucidité, aussi, avec les mots mis dans la bouche du flic désabusé sur les amours homosexuelles...)
Top 10 ?















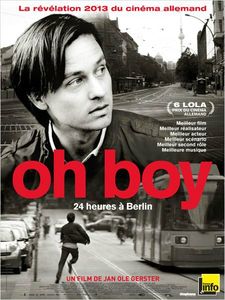

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)