58
WILLY 1ER
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier et Hugo P.Thomas,
Quatre (jeunes) réalisateurs, ça n'est pas très courant. On en avait dejà eu trois pour Party girl, qui ne m'avait pas complètement convaincu, et dont d'ailleurs, par moments, ce film n'est pas très éloigné. Par moments. Willy, c'est un personnage de fiction, mais créé d'après la "vraie" vie de Daniel Vannet, qui l'incarne d'ailleurs à l'écran. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, "en situation de handicap", qui, à la suite du suicide de son frère (dans le film, de son jumeau) décide de s'émanciper (il habite encore chez ses parents) et d'aller vivre sa vie, à pied dans un premier temps, dans le village voisin, à 9km... Il squatte d'abord chez un copain, puis chez sa curatrice (jouée par la seule actrice "professionnelle" du film, Noémie Lvovsky, magnifique de justesse et de simplicité) avant de s'installer dans "son" appartement, de rouler sur "son" scooter pour aller à "son" nouveau boulot. Boulot où il rencontre un autre Willy avec qui les relations, dans un premier temps, ne vont pas être des plus faciles. L'ensemble du casting est composé de non-professionnels, ce qui fait qu'il faut un temps d'adaptation pour se sentir à l'aise. J'évoquais Party girl, où on se retrouvait un peu dans la même situation (je pourrais aussi parler des films de Bruno Dumont) : des "vrais" gens jouant une presque vraie vie à l'écran, et pouvant provoquer le malaise (ce fut mon cas) dans des situations pénibles de réalisme (le syndrome Strip-tease) où il suffirait de peu de choses pour que le regard du cinéaste se teinte de voyeurisme ou de condescendance.
Mais dans le cas présent, les quatre jeunes réalisateurs revendiquent leur fascination (et leur complicité) pour le personnage de Willy. Ce que la narration traduit parfaitement. J'adore l'introduction dans l'histoire du "fantôme" du frère mort, intervenant régulièrement, jusqu'à la magnifique scène où les deux Willy(s) sont assis par terre devant leur voiture, au petit matin, avec chacun son fantôme venant à sa rencontre. C'est vraiment le moment, même s'il est tard dans le film, où ça a basculé pour moi. Oui, j'ai versé ma petite larme. Et tout ce qui suit sera tout aussi magnifique (à la fin, on a même, aussi, et je pense que c'est une première, un fantôme de voiture!). Et j'ai constaté, comme à chaque fois, combien c'est important, de pouvoir échanger, à la fin du film, avec le réalisateur (ou quelqu'un qui le représente) qui vous apporte des éléments nouveaux, ou une nouvelle façon de voir (d'appréhender) le film.

59
COSMODRAMA
de Philippe Fernandez
Philippe Fernandez, justement, s'était déplacé pour nous parler de l'ACID, de Willy 1er, et de son propre film (celui-ci). Cette soirée était prévue depuis belle lurette (novembre, me semble-t-il) mais n'a pu se concrétiser qu'en ce 23 février avec une soirée à deux films, qui sera suivie d'une semaine -ACID- à 3 films : Willy 1er, Cosmodrama, et Swagger. Un enchaînement de circonstances fâcheux (c'est souvent le cas) a fait que notre communication sur l'évènement n'a pas été optimale (et que la date retenue ne l'était pas non plus). Revenons à notre film. Il s'agit de science-fiction (mais c'est un peu un prétexte), où se réveillent, dans un vaisseau rétro-futuriste allant d'on ne sait pas où petit a jusqu'à on ne sait pas où non plus petit b, un certain nombre de personnes, des scientifiques plus un alienologue (un musicien auquel Sébastien Tellier prête ses traits) plus un philosophe/ psychologue /candide qui vont faire rien moins que de tenter de nous expliquer l'univers, le big bang, le cosmos, les trous noirs, le théorème de Gödel et autres joyeusetés futuristes, en même temps aussi vulgarisatrices qu'érudites (à moins que le contraire). C'est un peu comme si Science et vie ou La recherche s'étaient déguisées avec les sous-pulls en acrylique de Star Trek (le film est censé se dérouler en 1971) -les oripeaux de la (science-)fiction- pour mieux nous appâter. On vous montre des choses pour pouvoir vous en raconter d'autres. (Quant à moi, qui fus dans mes jeunes années un téléphage spécialisé dans les émissions bizarres, je me suis rappelé d'un téléfilm qui s'appelait La dame d'outre-nulle part. Le premier téléfilm de sf de l'ORTF. Ainsi que d'une histoire de navire de l'espace, vu un autre soir où je restais seul devant la télé, Icarie XB1.) Souvenirs souvenirs. Ainsi que les ouvrages de vulgarisation scientifique de G. Gamow, (avec ses aventures de Mr Tompkins) que j'avais dévorés à la bibliothèqe muncipale.
Le film est ce qu'il est (il m'avait moyennement enthousiasmé quand je l'avais vu en petit sur mon ordi, mais là sur grand écran ça n'avait plus rien à voir.) Même s'il ne pas toujours complètement conquis, je suis sorti très content car par contre j'ai pris beaucoup de plasir à la discussion avec le réalisateur qui a suivi la projection. C'est toujours passionnant d'entendre quelqu'un vous exposer son point de vue, "son" projet (et de le comparer avec ce qu'on en a ressenti). Ce qu'il a voulu y mettre et ce que j'en ai pris. J'avais saisi le "sens général" du truc, mais certains détails, qui tenaient pourtant à coeur au réalisateur, m'en avaient complètement échappé (le chemin de croix, par exemple).




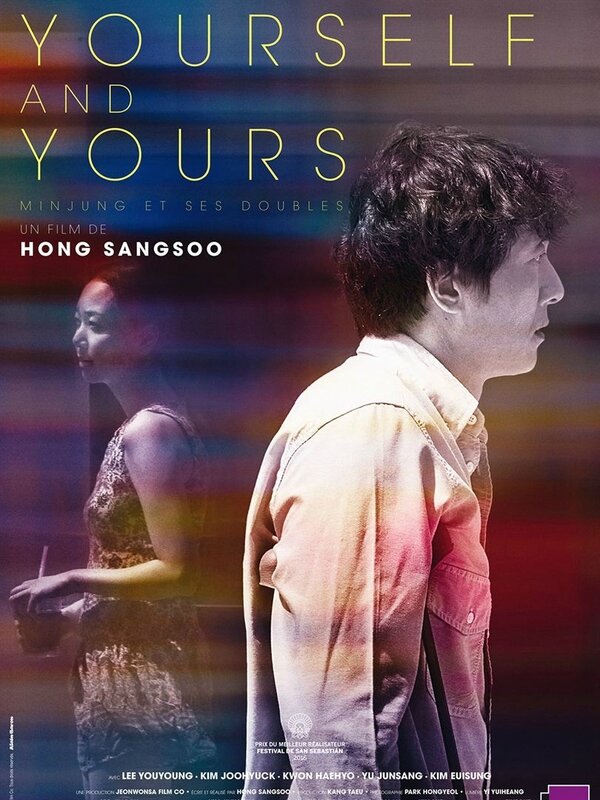
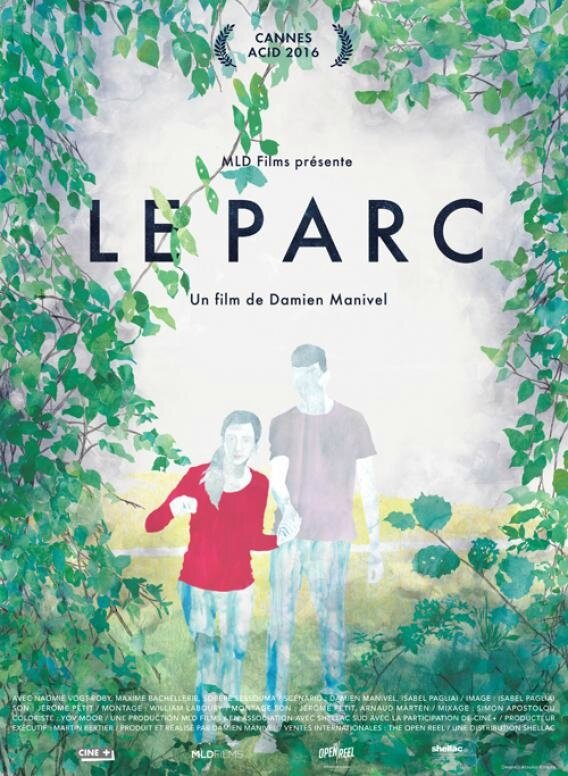









/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)