112
LE JOUR D'APRES
de Hong Sang-Soo
Allé à Besac tout spécialement pour le voir, quand j'ai appris qu'on ne pouvait pas l'avoir aux dates prévues dans le bôô cinéma. J'vais prévu de voir sans doute un autre film à la suite, mais j'étais tellement ravi en sortant de celui-ci que j'ai préféré rester sur le goût délicieux qu'il m'avait laissé.
Soyons clair : avec HSS, il s'agit d'une belle histoire d'amour qui dure... Avec, ça et là, des sommets, et parfois aussi, re-ça et re-là des petites baisses de forme. Là, on est au-dessus. Tout au-dessus.
D'abord parce que j'étais avec Mimichounette, qui a changé de film pour m'accompagner *, ensuite parce que je n'y ai pas -ô, prodige!- dormi une seconde, ce qui prouve à quel point j'étais captivé. Le film est dans un trés beau noir et blanc (j'ai pensé à Nuits calmes à Séoul, que j'avais adoré), utilise peu de décors (une cuisine, le bureau d'un éditeur, une restaurant chinois), et consacre beaucoup de plans (fixe) à des champs/contrechamps sur des hens qui parlent, qui discutent, qui échangent... voire qui philosophent (c'était justement le jour du bac de philo, et vous devez savoir la sainte horreur que j'ai de, justement, la "philosophie"), il sera successivement question de l'adultère, de la lâcheté, du réel, de Dieu, même (si, si), et, forcément, d'amour, et, forcément, de mensonge, d'échec et de tristesse aussi. Mais tout ça est léger et craquant et délicieux comme la plus fine et la plus exquise des gaufrettes.
Il est surtout question, finalement, de la pusillanimité (ce mot n'est pas dans la film, mais il me semble plutôt juste pour le décrire) du personnage masculin principal, qui tente (mollement) de se débattre, entre son épouse qui le soupçonne d'avoir une maîtresse, sa maîtresse, justement qui l'a quitté pour un autre, et la remplaçante de sa maîtresse, qui, le premier matin de son nouvel emploi, va être prise par l'épouse pour la maîtresse en question.
C'est un régal, il n'y a pas d'autre mot.
Comme d'hab' ça a l'air tout simple, fait avec deux bouts de ficelle et trois coups de cuillère à pot, ça ne paye pas de mine, mais c'est admirable. je vous l'ai déjà dit, je n'en ai pas perdu une miette.
Au début, comme d'hab' aussi j'étais extrêmement attentif, essayant de dénombrer avec précision combien il ya avait de femmes et combien d'hommes, et qui faisait quoi. Et le film progresse, finalement, d'une façon plutot linéaire (avec comme d'hab' des ellipses assez brutales, qui font croire parfois, à tort qu'il s'agit d'un souvenir, ou d'un fantasme, ou de je ne sais pas moi... mais non c'est juste l'histoire qui suit son cours, et les acteurs qui expérimentent diverses choses. l'impression très nette de déjà vu qui se dégage de l'avant-dernière scène se justifie, , en fin de compte, à la perfection. Et c'est la deuxième fois qu'on voit, dans le dernier plan d'un film d'HSS, une demoiselle qui s'éloigne, de dos, sous la neige... (petit jeu -dont je ne connais pas la réponse : c'était dans quel film, l'autre fois?)

(et j'aime beaucoup l'affiche, en plus...)
* (même qu'au début nous étions seuls dans la salle et que nous avons chanté "les fiancés d'Auvergne")
























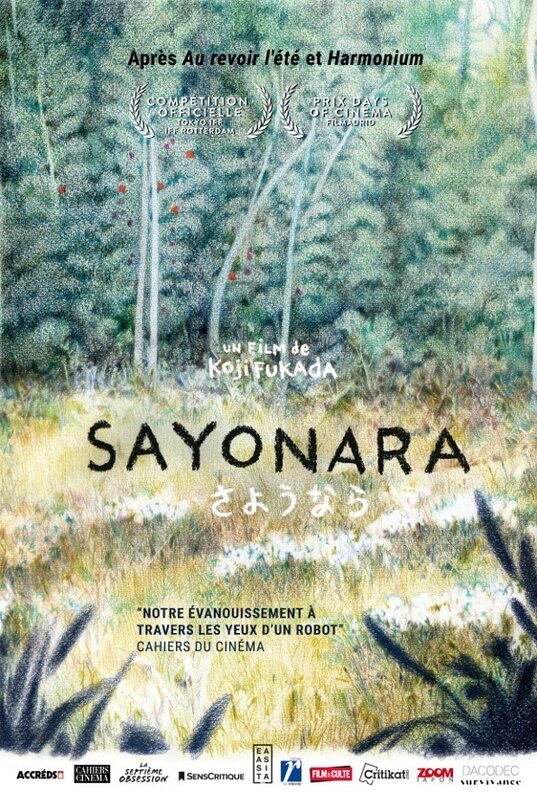

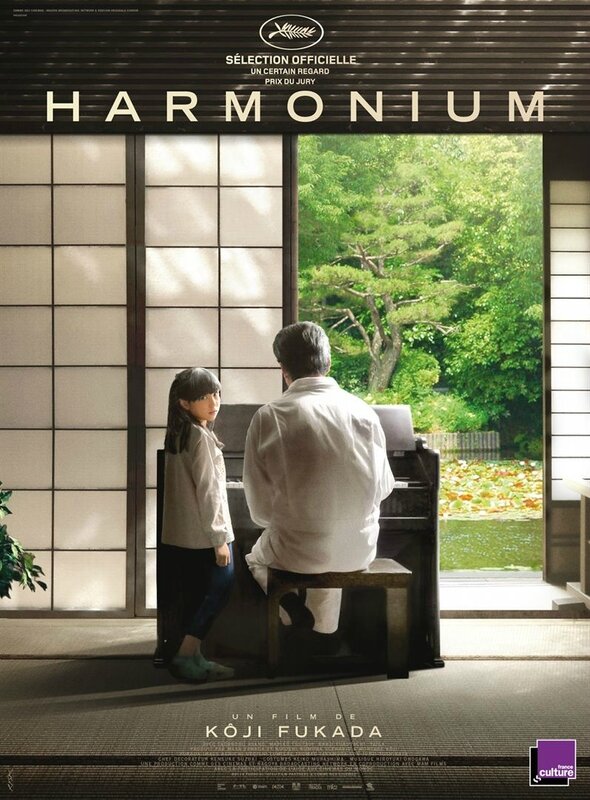


/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)