110
LA FLOR Partie 4
de de Mariano Llinás
Mes mômes, plutôt, faudrait-il dire (et chanter), puisqu'elles sont quatre. Les quatre actrices magnifiques de ce film au long cours, dont on a vu ce soir la dernière partie (puisque la -jusqu'ici- judicieuse séance du vendredi 13h30, à laquelle nous étions restés fidèles pour les trois premières parties est, on se demande pourquoi, passée hop! à la trappe cette semaine).
Nous étions dix dans la salle 10 (aux fauteuils plutôt inconfortables, avons-nous tous reconnu), dix complices, dix conjuré(e)s réunis par cette même envie de savoir la suite (et la fin) de l'histoire (des histoires plutôt), avec chacun(e) cette même préoccupation "J'espère que je ne vais pas m'endormir...". (Et le sentiment, aussi, d'avoir le privilège d'assister à un événement assez exceptionnel, et de le partager.)
Nous étions restés en suspens (CONTINUARA...) devant une voiture perchée dans un arbre et le film redémarre grosso modo à ce moment, mais dans l'Episode 2 ("les lettres de Gatto") où on va continuer l'histoire mais en changeant de point de vue, via le regard d'un autre narrateur, Gatto, (celui qui était arrivé pour étudier les phénomènes arboricoles top secreto). Qui se retrouve dans la chambre 333 d'un motel mi-bunker mi-asile, à correspondre avec Smith via internet (ah le bruit ineffable de mise en route du modem, qui nous ramène 20 ans en arrière...), à propos des passagers de la fameuse voiture perchée, qu'on a retrouvés complètement zinzins, excepté celui qui conduisait et dont on n'a pas retrouvé la trace, et à essayer de reconstituer ce qui a bien pu leur arriver... (celui qui manque, bien sûr, c'est le réalisateur...), on suit ses courriels, jour après jour, jusqu'à bifurquer soudain sur une nouvelle histoire, celle de Casanova et de ses quatre maîtresses successives qu'il poursuit à travers l'Europe et qui se refusent à chaque fois in extremis à lui (et s'avéreront être des sorcières, celles vues précédemment) qui est le film que tournait notre réalisateur colérique et barbu préféré (celui qui, justement, est porté manquant...).
"Il y a, à la fin du quatrième épisode de La Flor, qui arrive au tiers de la quatrième et dernière partie, juste avant l’ultime interlude annonçant les cinquième et sixième épisodes, une sublime coda. Vous n’avez rien compris ? C’est normal, du moins si vous n’avez pas encore vu le film. La raison pour laquelle on insiste néanmoins sur cette séquence, c’est parce que, telle une clef de voûte, elle fait tenir ensemble toutes les pierres de la cathédrale – et aussi parce que se sentir perdu dès la première phrase d’une critique de La Flor est assez fidèle à l’expérience de son visionnage. Cette séquence, n’ayez crainte, nous ne la déflorerons pas ; tout juste dirons-nous qu’elle permet de saisir ce qui fascina Mariano Llinás le jour où il découvrit, dans un petit théâtre de Buenos Aires, ces quatre actrices géniales que sont Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa et Laura Paredes, au point de vouloir réaliser, sur elles, pour elles et avec elles, une fiction de quatorze heures, tournée pendant dix ans, divisée en six épisodes, de genres et de durées différentes."
(Les Inrocks)
Celui de la Flor, par contre, (le "vrai") on le retrouve alors, au même endroit qu'au début de la Première partie, à sa table de pique-nique, qui vient nous annoncer que, eh bien, là, il reste encore la cinquième et la sixième partie et qu'après ahem ça sera fini, et le voilà qui récupère tout son petit bazar, carnet, stylo, verre, bouteille d'eau, et fait table nette avant de lever le camp et de nous laisser là en plan (il part dans sa voiture mais nous a fait un signe d'adieu)
vivre deux expériences de cinéma successives inédites (et inouïes) : la partie V est un remake (un hommage) à Une partie de campagne, de Jean Renoir, une re-création argentine (avec des gauchos) dans un noir et blanc sublime, d'un film dans une version totalement muette (et silencieuse aussi) excepté une scène où il aura conservé les dialogues de la version originale de Renoir (mais, paradoxe, plus du tout les images). C'est rare de passer, au cinéma, autant de temps dans un silence total, où chacun ne perçoit que les bruits intimes /infimes des autres spectateurs, tandis que la fiction recréée (la partie de campagne) cède soudain provisoirement la place à une observation du réel, prise au vol, c'est le cas de le dire, par le réalisateur (d'abord avec les dialogues de Renoir puis à nouveau dans le grand silence blanc).
avant que de repartir ailleurs, et que la partie VI (Les prisonnières) ne nous fasse reculer encore d'un bond dans l'histoire du cinéma (après le noir et blanc muet, voilà carrément le cinéma des origines, pour un épisode filmé entièrement en camera oscura (ce procédé rudimentaire et primordial, en gros une boite avec juste un petit trou en son centre qui laisse passer la lumière et capture les images à l'envers), générant des images un peu brumeuses, à la façon des autochromes de Lartigue, élégamment floues, consacrées une dernière fois- uniquement à nos quatre actrices, qui se mettent à nu, tandis que des intertitres (disposés manuellement devant la caméra) nous relatent en parallèle un récit de voyage écrit par une femme en 1900, à propos d'étrangère(s)...
et c'est fini (ou presque) car déjà commence le générique (et quel générique!), à la façon de la camera oscura, donc, reproduit à l'envers (la tête en bas, aux antipodes, normal), où on voit (de façon affectivement documentaire) s'activer dans un genre de ballet gracieux, à peine un peu ralenti, l'équipe technique en train de ranger tout le matos, tandis que sur l'écran défilent (écrits à la main) les noms des centaines et des centaines de personnes qui ont participé (contribué) à cette épopée cinématographique, pendant trente-cinq minutes, tout de même!, tout ça accompgné avec voix et guitare par le musicien du film (une "chanson" originale interprétée et re-, y compris, en plein milieu une version -en français avec accent argentin puis en argentin du cru- de Ma môme (oui, celle de Ferrat)-, une chanson de générique qui se répète, bifurque, louvoie, sinue et se réinvente (à l'image du film lui-même), jusqu'aux tout tout derniers remerciements, qui donc nous accompagne, tandis que la caméra, finalement, a repris ses esprits, s'est remise à l'endroit, et s'attarde sur un jeune homme assis sur une chaise longue rouge et blanche au milieu de la pampa (qui était d'ailleurs là depuis le tout début du générique) tandis que la nuit descend
(que la nuit descend)
et puis voilà c'est vraiment fini, et se rallument les lumières sur les visages complices des spectateurs à la fois visiblement réjouis, bienheureux, et un peu perdus de retrouver la réalité, comme se demandant ce qui vient de se passer... Il est minuit passé nous sommes les derniers à quitter le cinéma (qui d'ailleurs s'éteindra derrière nous quand nous aurons franchi les portes...)
"S’il était donné de rendre compte de l’expérience parcourue d’une phrase, La Flor est le roman-photo des vies qui l’ont fabriqué. Telenovela ouverte aux quatre vents aussi réflexive qu’introspective, qu’on dirait filmée simultanément par : Godard (les gros plans des visages en amorce, le merveilleux usage dramatique de la musique – de Gabriel Chwojnik – et du son en général fait de ventriloquie, de désynchro post-synchro), Oliveira (rapport avant et arrière-plans, flous qui s’ensuivent, narrateurs en voix off et «techno des enfers»), Rivette et Lang, et Feuillade (jeux de l’oie, réseau d’espions, filles du feu en cuir, sociétés secrètes), Hugo Santiago, Ruiz, Fassbinder, Arrieta, et cætera." (Libé)

Pour conclure, allez voir là le très beau et juste texte de Philippe Lefait (et des mots de minuit).


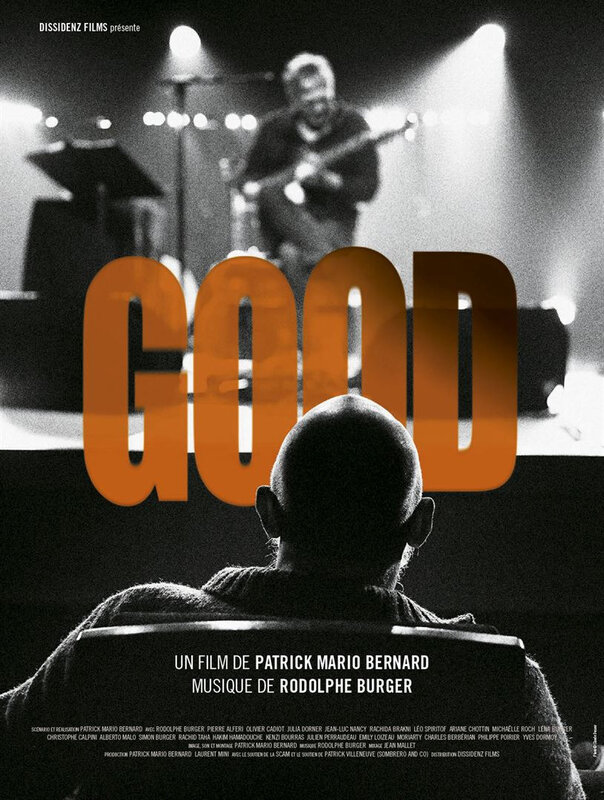











/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)