sauterelles
CITIZEN DOG
de Wisit Sasanatieng
Vu le lendemain de Flandres dont c'est l'antithèse (l'antipode ? ) parfaite. Film thaï (de guêpe ? ), barjo, frappé, secoué, zinzin, drelin drelin et compagnie...
Ca pourrait être un pop-hop, un de ces livres animés de mon enfance, où, quand on ouvrait les pages, hop! surgissait et se dépliait entre elles un élément, comme jailli en relief. Sauf que là, le texte de l'album (qui bénéficie même d'un narrateur en voix off ) serait écrit en thaï (langue écrite assez jolie à regarder, avec des bitonios qui se tortillent au-dessus des lettres) que chaque image a l'air d'avoir été coloriée à la main tellement ça paraît somptueusement chromatique et merveilleusement artificiel, et que l'histoire est suffisamment... inhabituelle pour avoir des airs de conte des mille et une nuits sous acide.
Ca pourrait être une sorte d'abécédaire déjanté : D comme doigt dans une boîte de sardines, G comme grand-mère réincarnée en gecko, M comme montagne de bouteilles en plastique, N comme nounours qui clope, P comme pluie de casques de moto, Q comme queue (celle qui vous pousse au derrière si vous allez dans la capitale...), S comme sauterelles sautées (à la poêle),T comme taxi-moto serviable (mais un peu zombie)... A chaque lettre sa surprise, et hop on tourne la page et ça continue, que va-t-on découvrir ?
Ca pourrait raconter l'histoire de Pott le jeune héros, qui quitte sa province natale pour "monter" à Bangkok, malgré la menace de sa grand-mère s'il réalise son projet (voir à la lettre Q)... Il y perdra un doigt dans une conserverie de sardines, en retrouvera un autre aussi sec, mais surtout rencontrera l'amouuuuur en la personne de Jin, une demoiselle rencontrée dans l'ascenseur, toujours plongée dans la "lecture" d'un livre blanc qu'elle ne comprend pas (et pour cause, il est écrit en italien!)...
Ca pourrait être aussi un genre de catalogue, de fourre-tout cinématographique, de bazar à la Méliès, où l'on expérimente/inventorie les différents effets, techniques, de style, de caméra, de narration, de lumière, en les illustrant à chaque fois , mais sans volonté didactique lourde, juste comme ça, pour voir, pour le plaisir...
Ca pourrait donc être un petit film charmant, naïf, plein de trouvailles, de n'importe quoi(s) ravissants, drôles, attendrissants. Avec juste une petite réserve : la musique (car c'est aussi parfois une comédie musicale!) un peu trop proliférante à mon goût avec les choeurs chabadadada mais bon dans toute chanson, aussi thaï et fine qu'elle soit, il faut bien aussi des bémols de temps en temps... Hard candide ?


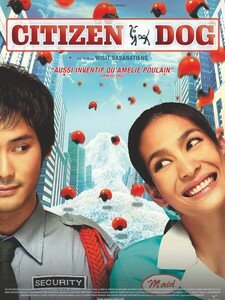
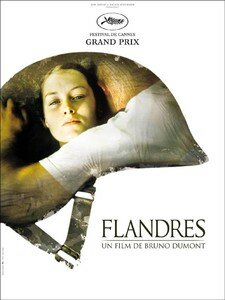





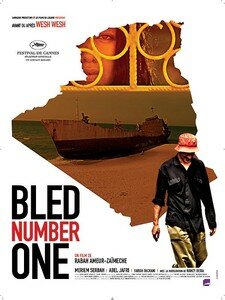

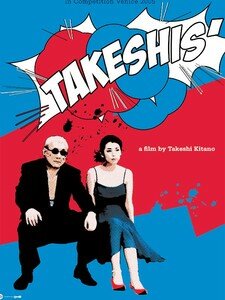

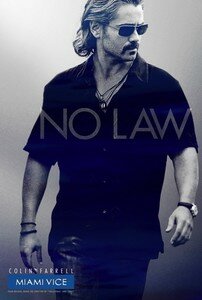
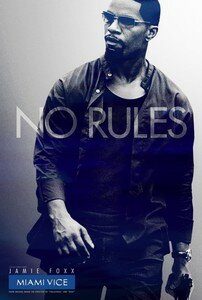
/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)