splendeur 3
073
MY WAY HOME
de Bill Douglas
Et j'ai enfin pu terminer la trilogie de Bill Douglas, avec ce dernier volet (à peine un peu moins effroyablement noir que les deux précédents, mais tout aussi sublime...) de son histoire. Sa propre enfance. Le héros, Jamie, est désormais dans un orphelinat, toujours aussi seul, aussi triste, aussi opaque, aussi en colère, mais objet (comme les autres pensionnaires) de l'attention aimante du directeur de l'orphelinat, un gros bonhomme mélomane et touchant (une histoire magnifique d'harmonicas). Orphelinat dont viendra soudain le retirer son père, "qui pensait bien faire", pour le ramener à la maison où l'ambiance est toujours aussi instable et aigre (et sonore).
Bill Douglas enchaîne ensuite quelques épisodes de la vie de Jamie, souvent centrés sur un accessoire (un livre, des pommes dans un plat, un tas de charbon, un panneau indicateur de gare) et un lieu pour nous raconter, a minima, les nouvelles étapes de son périple. On est désormais attentif aux virages qui reviennent régulièrement dans le cinéma de Douglas. Qui dissimule ce qui s'en va (où ne laissait pas voir ce qui arrive).
Puis le film s'illumine, littéralement : Jamie est désormais militaire (de la RAF) en Egypte, il est occupé à peindre une ligne de briques posées alternativement en noir et en blanc, et il fait la connaissance de Robert, un autre soldat juste un peu plus âgé, qui lui offre son amitié, qu'il va finir par accepter.
Plus question ici de froid, de violence, de noirceur, de crasse, de hurlements. Une vie militaire faite surtout de corvées, d'inaction, et d'attente, toujours dans la même stylisation splendide qui tirerait parfois le récit quasiment vers l'abstraction (via la métaphysique du Désert des Tartares...), toujours à partir de choses simples : du sable, des traces de voiture, un insecte, un appareil-photo...
Le film se clôt (sans effusions excessives...) sur une image silencieuse mais riche de promesses.
L'acuité du regard de Bill Douglas est sidérante. Faisant du malheur un état de fait, et non pas un sujet d'attendrissement (ou un objet de compassion.) C'est comme ça, point. (Ou "c'est comme ça que je vous le montre, point.")
Ce qui me touche encore plus, bien sûr c'est que, à chacun des âges, dans chacun des trois films, c'est à chaque fois un homme qui aidera le jeune Jamie (le soldat allemand, le grand-père, le directeur de l'orphelinat, et Robert...)
Bill Douglas est mort en 1991. Il aura juste réalisé cette trilogie (3 films d'une heure ou presque) et Comrades (une film de trois heures ou presque). Son acteur principal, Stephen Archibald (son Jean-Pierre Léaud à lui) est mort très jeune, à 37 ans.
"La force insoutenable de la mise en scène de Bill Douglas tient au fait que son désir de voir ne découle jamais d’un désir intellectuel de comprendre. “On pourrait croire que je suis opposé à la compréhension, mais avec ce film il ne s’agit pas a priori de comprendre, mais de sentir. Et la particularité de ce film est que les deux ne peuvent pas, comme dans la structure classique, aller de pair.” Cette vision du monde s’ancre dans une méthode : choix d’acteurs non professionnels à qui le cinéaste demande de revivre sa propre enfance (“Je suis content de ne pas être toi”, lui dira Stephen Archibald) ; tournage obligeant l’équipe à retraverser la dépression, la terreur, l’injustice, les failles intimes du cinéaste, mais, avant tout, celles de chacun. “Si je ne ressens rien, alors je sais que c’est faux”, disait Bill Douglas." Les Inrocks
illustration trouvée sur Filmoteca Hawkmen Blues,
le blog magnifique d'un cinéphile archiviste español, ici.





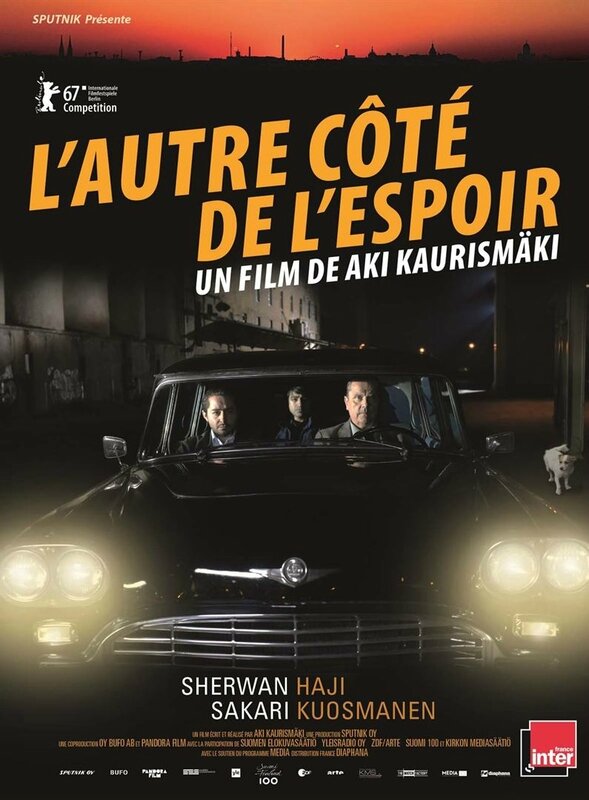
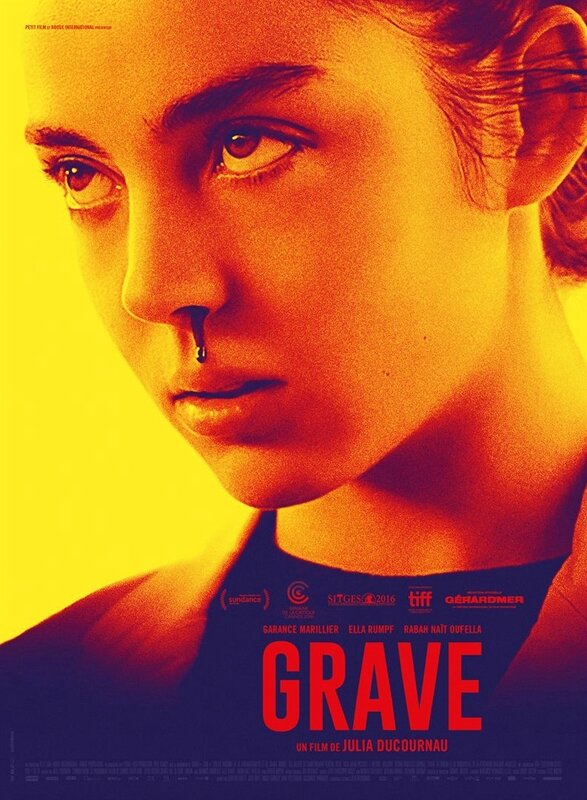






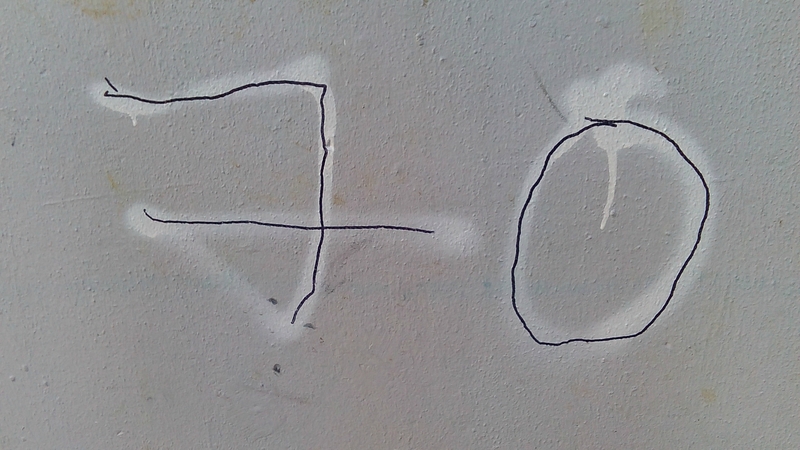
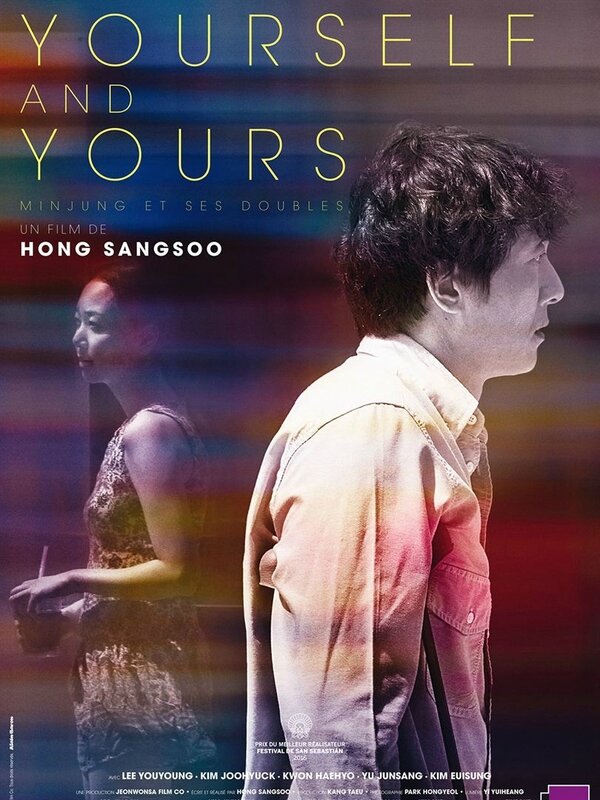
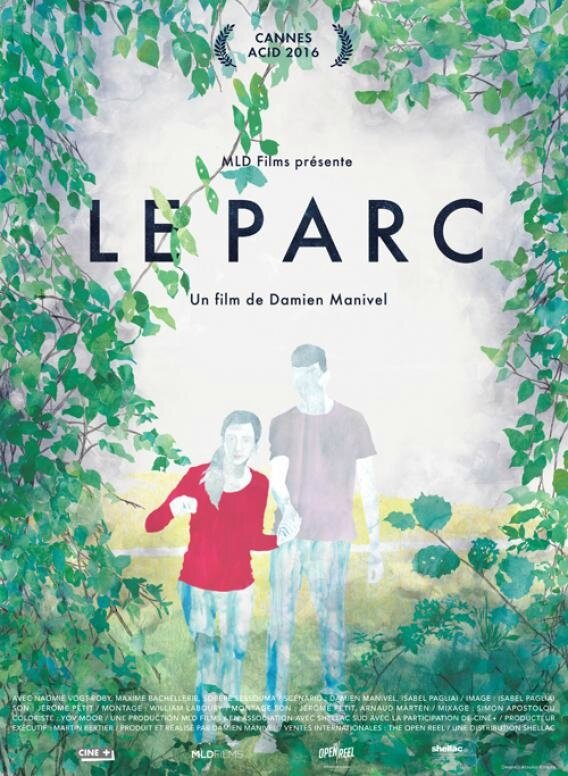

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)