le bulldozer et la voiture
067
FOXTROT
de Samuel Maoz
Celui-là j'en avais très très envie. Un film israélien, que voulez-vous, je suis incapable de résister... En plus avec le superbe Lior Ashknenazi (celui-là je l'aime depuis son premier film, Mariage tardif, en 2001, et qu'est-ce qu'il vieillit bien...), je fond. Et quand il s'avère in fine qu'on y entend le sublime Fur Alina d'Arvo Part, (qui m'évoque biens sûr Gerry, de Gus Van Sant, mais aussi, et surtout -tiens ça faisait longtemps- le jeune homme au t-shirt vert...) alors là je me liquéfie de bonheur.
Le titre du film n'est pas anodin (et l'insistance du réalisateur à faire, justement, exécuter cette danse au cours du film, non plus). Donc, globalement, on change de position, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à revenir au point de départ. Et c'est très exactement ce que fait le film (la route à travers le pare-brise qu'on voit tout au début étant le point de départ, mais aussi donc le point d'arrivée.)
Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça.
Le film est donc divisé en quatre blocs, le premier dans l'appartement ("les parents"), le deuxième au check-point ("le fils") le troisième à nouveau dans l'appartement, la cuisine surtout (re-les parents) et le dernier (l'épilogue) dans la voiture (re-le fils). Quatre moments d'une même danse (même si le réalisateur prend quelques libertés avec l'enchaînement des pas et place le 4 avant le 3) tous d'une belle force et en même temps forts d'une belle différence.
L'histoire de cette famille évoque en parallèle (en filigrane) celle d'un peuple, comme le souligne le réalisateur dans une interview, et chacune des quatre parties est construite autour d'une erreur (ou d'une méprise). Chacun des segments narratifs, d'ailleurs, pourrait pratiquement être vu seul, tant il a sa thématique propre (et sa propre stylistique aussi). Dans la première, on frappe un matin à la porte d'un couple (les parents, donc), ce sont des militaires qui viennent leur annoncer que leur fils est "tombé au combat", avant que, une demi-heure (de film) plus tard, ces mêmes militaires reviennent pour leur annoncer qu'il y a eu une "épouvantable erreur" et que le Yonathan qui est mort n'est pas leur Yonathan à eux. Dont le père exige alors l'immédiat rapatriement.
D'un huis-clos poignant (comment faire face à la mort annoncée de son enfant) on va passer sans transition à un ailleurs quasi surréaliste, un unviers qu'on croirait hallucinogène, bref un check-point de trou du cul du monde (ambiance quelque part entre Beckett et le Désert des Tartares, un genre d'absurde kafkaïen où le rire est toujours sous-tendu par une certaine angoisse...) où officient quelques jeunes recrues qu'on croirait presque avoir été oubliées là. Dont le Yonathan du couple vu précédemment. Un Yonathan pas mort du tout, dans un check-point où passent surtout les chameaux, mais de temps en temps des véhicules contenant des civils forcés de se conforter, face à la barrière baissée, à la même procédure anxiogène de vérification des papiers. Jusqu'à ce que ladite barrière se relève pour les laisser passer. Sauf que, en écho à la première partie, les jeunots eux aussi commettent une erreur. Une bévue, une boulette, une bourde, mais de taille XXL. Qui sera pourtant couverte (et recouverte, même) par leur hiérarchie. jusqu'à ce qu'un gradé vienne chercher Yonathan pour le ramener, manu militari (enfin, dans le cas présent jeepu militari) à la maison, comme l'a exigé son père. Avant la troisième partie, où l'on revient dans l'appartement des parents, mais dont je ne vous dirai rien de plus pour ne pas gâcher votre plaisir... Et donc pas un mot non plus sur l'épilogue (dont on se doute un peu quand même, au vu de la scène d'ouverture et de la troisième partie...).
Un film impressionnant (j'adore entendre parler en hébreu, je ne sais pas pourquoi), formellement hyper-chiadé (tiens, pour chipoter, on pourrait presque lui reprocher ça, au réalisateur, d'être "trop sûr de ses effets", d'abuser de la virtuosité, mais bon ça serait vraiment juste pour le plaisir de jouer le vieux ronchon du Muppet, hein...), qui est aussi brillant et à l'aise dans l'univers du drame, de l'absurde, de l'affectif, bref qui tient sa note et la tient bien, et jusqu'au bout...
C'est le deuxième film du réalisateur après Lebanon, que je pensais avoir vu mais dont je ne trouve nulle place sur ce blogchounet (peut-être ai-je confondu avec Beaufort, autre film que j'adore ?) Et donc à présent la mission que je me suis fixée est bien sûr de dénicher Lebanon et de le visionner...






























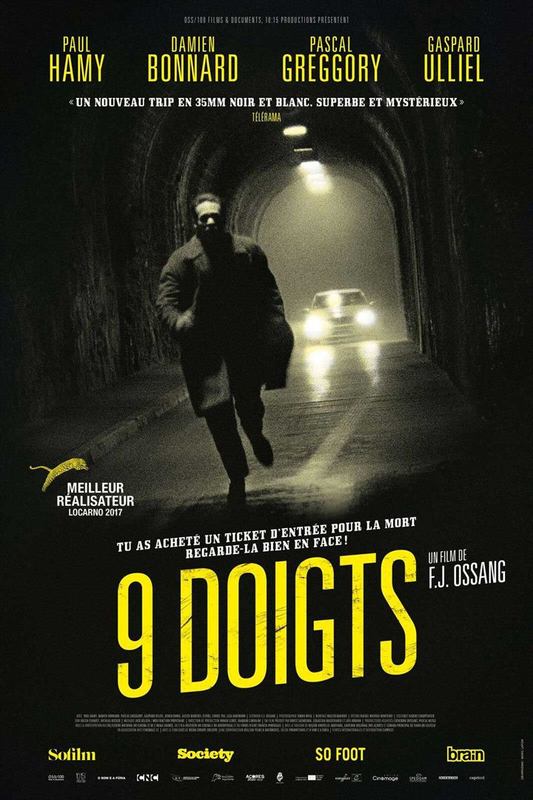
/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)