C'est Rocco mon pitbull...
QUAND VIENT LA NUIT
de Michael R. Roskam
Pour le titre désolé, ça a été plus fort que moi, rapport à une chanson d'Oldelaf qui me tourne dans la tête, mais où le pitbull s'appelle Raoul... en plus, celui du film y a une importance certaine (même si c'est juste un bébé) et donc on va dire que ça le fait... Le film, j'en avais envie surtout parce que James Gandolfini (qui dans une autre vie télévisuelle s'appela Tony Soprano) et aussi, pourquoi pas Noomi Rapace (Millenium 1) et Matthias Schoenaerts (Bullhead) mais aussi, après coup, Tom Hardy (je ne le connaissais pas avant, puisqu'il n'a joué que dans des films que je n'ai pas vus), dans le rôle principal, idéalement atone.
La bande-annonce en semblait attractive, polar nocturne, atmosphère, Brooklyn, old school, ombre tutélaire James Gray, allons-y donc, d'autant plus quand Dominique m'apprit que c'était adapté de Dennis Lehane (mais de quel roman donc, me suis-je longtemps demandé, avant d'apprendre, à la sortie, qu'il s'agissait d'une nouvelle). C'est le genre de film dit en pelures d'oignon, où , après un départ relativement simple et carré : tac tac tac un personnage deux personnages trois personnages, un bar, un bébé chien, et hop!, il va vite s'avérer que les choses ne sont pas du tout aussi simples qu'il semblerait, et on commence à ôter les épidermes les uns après les autres, disons qu'ils s'effeuillent tout seuls au fur et à mesure qu'on en apprend de belles sur chacun , que personne n'est vraiment tout à fait celui qu'il/elle veut bien paraître, que les choses s'enveniment, que les menaces et/ou leur mise à exécution se succèdent, et qu'on en arrive à craindre, dès qu'on voit un personnage, de quel côté il va bien pouvoir s'en prendre une (ou à qui il va bien pouvoir en coller une, c'est donnant-donnant).
Une histoire d'hommes, essentiellement, qui aurait presque -je dis bien presque- pu tenir debout sans le personnage de Nadia (mais à ce compte-là, idiot que je suis, on pouvait aussi enlever le chien, non ? Et puis tous les personnages, un par un, tant qu'on y est, non ? bon bon je retire ça.) C'est vrai qu'il est de tradition, dans les films de mauvais garçons, d'avoir une chouette pépée, à jambes interminables et à fume-cigarette langoureux, quelques grammes de rimmel, ou de carmin, dans ce monde de brutes... Là ça n'est pas tout à fait ça, (Noomichounette joue, contrairement à ses habitudes, une demoiselle fragile et tremblante) mais ça nous ferait presque lorgner le thriller velu vers la bluette rafraîchissante, l'idylle roucoulante, la love story brooklynante. presque, je dis bien.
J'ai déjà dit que j'étais bon public, et ça s'est encore vérifié : là, il s'agissait être stressé, et bingo! c'est bien dans cet état que j'ai vu le film : un certaine tension, les poings serrés, le souffle court (je ne suis pas seulement bon public, je suis aussi très imagé) on n'y a pas souvent l'occasion de le reprendre (son souffle)..
Cette histoire d'argent sale blanchi dans les bars, de bébé-chien tabassé, de jeune fille instable, de petit ami encore plus instable juste sorti d'hosto psy, de mafieux tchétchènes qui clouent les jambes, de hold-up foireux, de billets sanglants, on sait bien depuis le départ, que ça ne peut que mal se terminer (voire très mal ou même très très mal), mais le réalisateur parvient tout de même à nous surprendre en bouclant le tout d'une façon à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Et en rajoutant hop! une louche dans notre stupéfaction de spectateur. Ca finit, en plus, d'une façon délicieusement amorale (je ne vous dis pas pour qui...) donc, le contrat est rempli. Sauf que le tout dernier plan n'était peut-être pas tout à fait indispensable, un peu comme si on avait ajouté in extremis un joli ruban autour de disons un fusil à pompe...




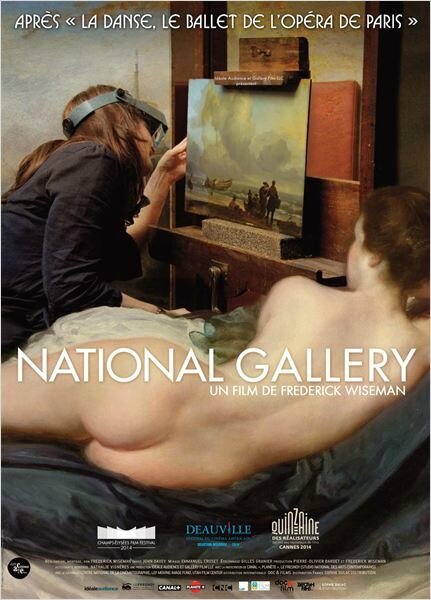








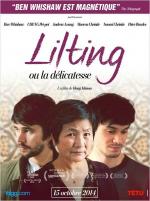







/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)