YUMURTA
de Semih Kaplanoglu
J'aime le cinéma turc. Enfin, ce cinéma turc là.
Avec une scène d'ouverture qui me fait instantanément venir les larmes aux yeux tellement elle est belle : Plan fixe, petit matin, champs embrumés, s'approche de nous, depuis le fond du paysage, une vieille femme qui marche, fatiguée, jusqu'au niveau de la caméra, puis continue, de dos, jusqu'à disparaître, point minuscule, dans le néant, de la même façon qu'elle venait d'en émerger.
Yusuf (un charmant barbu à l'air taciturne), ex poète (pourquoi ex, après tout ? poète un jour, poète toujours, non ?), bouquiniste à Istanbul, revient dans son village natal après la mort de sa mère, qui est peut-être justement la vieille dame qui marchait dans la brume précédemment... (Il y a beaucoup de "peut-être" dans le film, puisque peu de choses y seront dites : à chaque spectateur de se faire sa petite idée et de recoller ce qui va avec quoi, d'autant plus que le héros dort (et rêve) beaucoup, dans les endroits les plus divers). Yusuf, donc, qui revient dans la maison de sa mère et y trouve Ayla (un jeune fille à la nuque émouvante et gracile), une demoiselle, lointainement de la famille, qui est venue aider sa mère. (Le film est peu bavard, et c'est rien de le dire). Yusuf pensait rentrer à Istanbul dès le lendemain, mais non finalement il prolonge, un jour, puis deux, puis... (smiley angélique : mais qu'est-ce donc qui le retient ?) Il est question de sacrifier un bélier (voeu ante mortem que sa mère a souhaité qu'il réalise pour elle), ce qu'il refuse d'abord mais finira par accomplir, par l'entremise d'Ayla.
Ayla qui est courtisée par un jeune homme (électricien de son état, -ceci a son importance-) , lui aussi noir de poil et mal rasé de charmante façon (je soupire) , qui serait peut-être plus de son âge, mais qu'elle met un peu sur des charbons ardents dans une situation d'attente, d'observateur, et donc de jalousie. Ayla et Yusuf. Ils se regardent en silence, ces deux-là... Juste les yeux qui parlent. Pourtant, le sacrifice accompli, il repartira (elle dira juste "au revoir" en sortant de sa voiture tandis qu'il lui sourit à demi, se tortillant, embarrassé, sans esquisser le moindre geste dans sa direction). Mais, après une nuit bizarrement passée dehors, avec un bizarre gros chien et de bizarres sentiments, Yusuf, finalement
(tss tss je ne vais pas tout vous raconter tout de même)
Un film très beau, (très triste ? non, non), articulé en somptueux plans-séquences, qui savent prendre leur temps, étirer leur propre présent, où ce que l'on ne dit pas, (ou ce que l'on ne parvient pas à dire, ou ce qu'on ne soupçonne même pas d'avoir envie de dire) est bien plus important que les maigres mots qui font la conversation "en surface" et le quotidien. A l'image de la toute dernière scène, d'autant plus forte qu'elle est simplissime, où, si le seul dialogue est ce " du fromage ?" / "non merci", et un duo de remuage de petites cuillères dans les verres la seule musique, ce qui s'y passe, ce qui s'y joue est autrement plus important, et n'est pas verbalisé parce qu'il n'y en a pas besoin.
Un film aussi simple qu'intelligent. Semih Kapanoglu fait cinéma de tout, le quotidien, les rencontres, le paysage, un bout de rue, un coin de cuisine, du vrai cinéma, du grand cinéma. Pas de musique (les deux génériques de début et de fin sont constituées de bruits, juste à chaque fois une petite histoire sonore à décrypter), une caméra discrète (peu de mouvements d'appareil, sauf si la scène s'y prête -cf la danse au mariage-) des cadrages simples, rigoureux, des acteurs en osmose, d'une justesse (je dirais même exactitude) confondante, et, toujours, ce sentiment que se qui se passe en réalité est bien plus important que ce qui est montré, que ce qui affleure. Et une façon inimitable, justement, d'insérer dans le récit les rêves de Yusuf, de banaliser la matière des songes en la lissant dans la trame du quotidien, du réel. Et j''aime énormément ce personnage qui s'endort, qui s'allonge, qui tombe, dans les endroits les plus variés.
Si le réalisateur, lors d'une interview, évoque Bresson, Antonioni et les frères Dardenne dans ses références/influences, il n'en construit pas moins son cinéma à lui, autonome, authentique, et a su, justement, s'en démarquer pour créer son univers personnel (même si c'est vrai que l'ombre amicale de Nuri Bilge Ceylan plane un peu par ici) Bresson ? mais avec moins d'austérité. Antonioni ? mais avec moins de drame. Dardenne ? mais avec moins de revendication sociale. Surtout ne croyez pas que le cinéma de Kapanoglu n'est qu'un cinéma du moins. Bien au contraire. Plus de tendresse, plus de temps, plus de non-dits, plus de finesse. Et si le désespoir y est tenu à l'arière-plan, c'est avec une extrême élégance.
Bonne nouvelle : Yumurta (l'oeuf) est le premier volet d'une trilogie autour du personnage de Yusuf ; les deux films suivants seront Süt (le lait) et Bal (le miel).

J'ai mis l'affiche originale, avec les arbres au fond qui "font penser à la cathédrale de Milan" (dixit Zabetta)


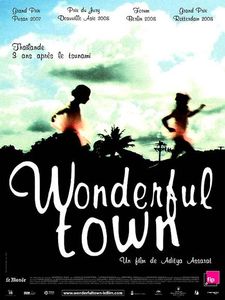









/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)