parapluie bleu
LUMIERE SILENCIEUSE
de Carlos Reygadas
Silencieuse, la lumière, et le film l'est aussi. Pas la moindre note de musique pour l'agrémenter, ni avant, ni pendant, ni après, excepté un extrait des "bonbons" de Brel (chanson que, innocemment, je n'avais crue susceptible d'être taxée d'homophobie, ce que pourtant il s'avéra.)
L'horloge (tictactictac) a tourné (quasiment deux tours et demi) on l'a arrêtée, on l'a redémarrée... Le temps passe, et Reygadas le prend (son temps). Le film s'ouvre sur un lever de soleil (quasi en temps réel) et se clôt sur un coucher du même. (Habile, on peut ainsi se repasser le film en boucle!). "Entre les deux, mon coeur balance, je ne sais pas laquelle aimer des deux..." (air connu) sauf qu'ici pas question de rigoler. On est au sein d'une communauté genre mormons hollandais installés au Mexique, 50% prière et 50% travaux des champs. Et voilà que Jonas (le héros) doute, entre son épouse (qui lui a donné une ribambelle d'enfants blonds et gracieux) et sa maîtresse (qui lui fournit étreintes torrides et culpabilité). Que faire ? Aller de l'une à l'autre, (certains ont le cul entre deux chaises, lui a le coeur entre deux femmes)jusqu'à ce qu'un accident cardiaque bienvenu... (mais on ne sera alors qu'à la moitié du film)
Je l'avoue, j'ai somnolé un chouïa, au début (Plans séquences "didactiques" étirés sur le lever de soleil, la prière du matin, la traite des vaches, l'ensilage du maïs. Comme dirait l'autre "C'est beau mais c'est spécial..." Oui c'est beau, très beau, mais...) jusqu'à ce qu'une coupure bienvenue ramène les lumières dans la salle et le sursaut salutaire qu'attendait mon intellect embrumé. On redémarre. Et le reste passe très bien. C'est vrai, après, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Peut-être que j'avais pris le rythme.
Les critiques ont exagéré (surtout celui de Libé après la projection à Cannes) ce n'est pas prétentieusement imbuvable, c'est juste sérieusement ambitieux. Et le résultat n'est pas forcément toujours à la hauteur de ces espoirs-là. C'est impeccablement composé, d'accord, et il y a, comme toujours chez Reygadas, des scènes qui en jettent (bien que, par exemple, le voyeur en moi ait été déçu, puisque, hélas, pas la moindre quéquette visible, mais c'est vrai que l'ambiance (surtout dans la deuxième partie) n'est pas vraiment à la gaudriole et aux chapeaux pointus).
Comme si le réalisateur s'était dit Je vais en remettre une louche : encore un peu plus de beau, encore un peu plus de long, (et de sérieux, et de mystique et d'épure) et avait voulu mettre en place un genre d'hyper-hyper-réalisme. (non, je ne bégaie pas!) On contemple, on admire, mais, comment dire, c'est un peu étouffant parfois... il manque quelque chose.
Tout ça pour dire que j'ai été moins séduit par celui-ci que par le précédent (Batalla en el cielo) où se passait vraiment pour moi quelque chose de neuf, question cinéma. Là on serait plutôt en terrain plus... connu. Oui, c'est beau, très beau, mais...





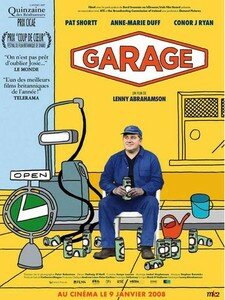

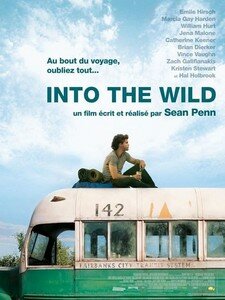





/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)