LA GRAINE ET LE MULET
d'Abdellatif Kechiche
(Enfin, enfin, du monde dans la salle! La malédiction du monospectateur semble enfin levée. Bon, c'était un régiment de trente mamies permanentées, mais mieux vaut elles que rien.)
Après l'Esquive, Abdel Kechiche monte encore l'exigence cinématographique (et le plaisir cinéphilique donc) d'un cran supplémentaire. Quel cinéma, quel beau cinéma! Où l'humanité de l'entreprise le disputerait à l'acuité du regard. Une caméra très mobile, au plus près des visages, un montage nerveux (mais jamais hystérique), des images pas forcement léchées, au service du portrait d'une famille de français d'origine maghrébine. Famille(s) nombreuse(s) puisque Slimane, le père, se partage entre son ex-femme (et ses quatre enfants) et sa nouvelle compagne (et la fille de celle-ci). Slimane, qui toute sa vie a travaillé sur les chantiers et va être licencié parce qu'il n'est plus rentable, et va utiliser ses indemnités de licenciement comme point de départ à un projet un peu fou auquel il veut associer tous les siens. Slimane qui rêve d'ouvrir, sur un rafiot rafistolé, un restaurant spécialisé dans le couscous de poisson, projet qui va prendre corps dans la longue (peut-être un peu trop?) partie finale du film.
La première partie (l'exposition) est extraordinaire, peut-être justement parce qu'elle n'a pas d'autre enjeu narratif que de nous présenter chacun des personnages des deux fratries dans leur(s) fonctionnement(s) habituel(s), partie qui culmine dans une superbe et longue scène de couscous dominical, tellement réussie qu'elle donne envie au spectateur de traverser l'écran pour aller s'atabler avec eux. La caméra est joyeuse et affairée comme une abeille en plein travail, elle va vient virevolte, s'arrête, repart... Une robe rouge, une étreinte furtive, des tapes sur des fesses, des ouvriers sur un chantier naval, un contremaître, une caisse de poisson... Le spectateur aussi butine, en fait aussi son miel. J'étais peut-être en état de réceptivité optimale, mais c'est vrai que j'ai passé mon temps à alterner reniflages (bon d'accord, Dominique m'avait refilé son rhume) et essuyage de larmes. Un genre de paroxysme émotif à éclipse (qui reviendra tout au long du film)
La seconde partie, plus documentaire ("administrative" ?) suit Slimane dans son parcours du combattant pour ficeler son projet (dossier, autorisations diverses, demande de prêt, précisons, détails, formulaire adéquat, rien n'y fait, il s'obstine, visage fermé, rides éloquentes, pas bavard, peut-être lui d'ailleurs le mulet du titre).
La dernière partie du film, à bord du fameux rafiot, capitalise les deux premières pour introduire une dramatisation narrative (une narration dramatisée ?) du récit, basée sur une, puis deux situations d'attente, de plus en plus insupportables, dont le prosaïsme de la première : nos amis vont-ils récupérer le couscoussier ? louvoie entre thriller berbère et poésie barbare, tandis que la seconde, dans sa répétitivité, confinerait presque à l'abstraction (méta)physique (avec, en filigrane, une troisième, induite, celle du spectateur : c'est peut-être à dessein justement que cette partie est étirée jusqu'à son paroxysme, culminant dans cet haletant montage alterné : une jeune femme danse, un vieil homme court...) jusqu'à cette rupture sèche, qui a l'élégance de ne pas dénouer gracieusemement toutes les lignes (de force ou de faille) du récit, et d'utiliser les points de suspension plutôt que le rassurant point final.
Comme la vie, quoi, tout ne finit pas forcément youp la boum pour tout le monde, tout n'est pas expliqué explicité souligné, le spectateur n'est pas rassuré dorloté dans le sens du poil avec joli récit-cadeau bien empaqueté bien ficelé bien clos...
Quant aux acteurs, autour de Habib Boufares (Slimane), ils se bousculent au portillon de la justesse (et donc des compliments) et mériteraient tous une mention (tiens d'ailleurs les voilà : Hafsia Herzi, Faridah Benkhetache, Abdelhamid Aktouche, Bouraouia Marzouk, Alice Houri, Leila D'Issernio, Abelkader Djeloulli, Olivier Loustau, Sabrina Ouazani, Mohamed Benabdeslem, Bruno Lochet, Cyril Favre, Sami Zitouni, Mohamed Karaoui...) tellement ils sont bien bien bien et qu'il est ardu de différencier les non-professionnels des acteurs confirmés (j'ai un faible pour le beau-frère très pas rasé mais bon ça n'a rien à voir avec son jeu, ce n'est pas objectif...), et comme dans l'Esquisse, on pourrait dire que ce sont les filles qui tirent la couverture à elles, que ce sont elles qui mènent le jeu, qui font bouger les choses, qui s'en sortent avec les honneurs, mais les mecs les méritent aussi, et oui tout l'monde tout l'monde tout l'monde...
Juste après Faut que ça danse! un autre film sur la difficulté de vieillir, sur les illusions qu'on perd, mais aussi sur les actes d'amour, sur la générosité, sur l'espoir comme ciment universel de nos branlantes constructions individuelles...
Oui, certains cinéastes devaient bien en prendre de la graine...





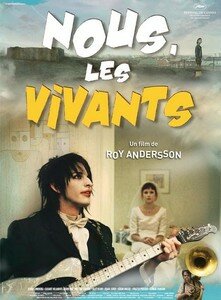

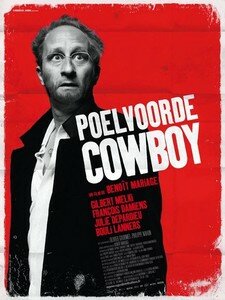


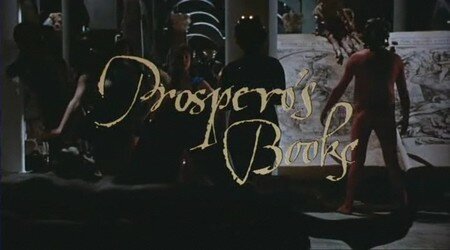





/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)