ma tasse de thé
L'HEURE ZERO
de Pascal Thomas
Quel plaisir de chausser de bonnes vieilles charentaises cinématographiques... Une adaptation d'Agatha Christie (je l'avais lu il ya longtemps mais n'en avais gardé quasi aucun souvenir, à part le coup de l'ascenseur en panne, qui m'avait à l'époque plutôt ravi... quelle élégance et quel sens de l'économie dans le meurtre!) avec of course son manoir anglais, ses majordomes, sa vieille lady excentrique, ses clubs de golf, ses tasses de thé, ses doigts de brandy, ses secrets de famille, ses machinations machiavéliques, ses faux indices, ses vrais criminels qui grimacent lorsqu'ils sont démasqués... bref tout y est de a jusqu'à z, y compris le deus ex machina et le twist final : mais alors, s'il n'y avait pas de lune et qu'il pleuvait ???Rajoutez-y une distribution aux petits oignons : Danielle Darrieux en mamy opiomane, Melvil Poupaud tout en gomina et en oeil de velours, François Morel en enquêteur, et un duo d'étonnant d'antagonisme : d'un côté la blondeur très extravertie (c'est le moins qu'on puisse dire) de Laura Smet et en face la tristesse toute en retenue de Chiara Mastroianni. Visiblement tous s'amusent à composer, jouer (et parfois surjouer ?) leur personnage, et nous aussi du coup. Mais pas immédiatement.
Car tout ça reste assez "sérieux" en apparence (les intrigues d'Agatha ne sont pas réputées pour leur rythme trépidant ni leurs poursuites echevelées, hein ?) Classique, donc : il faut se fader une exposition longuette (le temps de présenter tout le monde, et de montrer que chacun aurait une bonne raison d'avoir zigouillé ceux qui le furent (ou de pouvoir zigouiller ceux qui le seront ?), qui serait laborieuse si ne venaient, à intervalles réguliers, se mêler à la narration plutôt straight des décrochages plutôt loufoques (les domestiques).
Le dénouement n'est pas, une fois de plus, le moment le plus inoui ni le plus inattendu (Trop d'indices tuent les indices, n'est-ce pas ?) mais bon, on sort de là, plein d'indulgence, c'était un dimanche soir, et on a vu un bon film de dimanche soir...





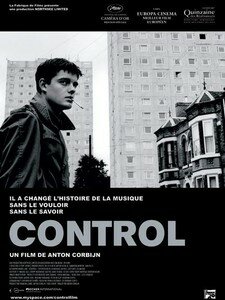



/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)