vide-ordures
4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
de Christian Mungiu
On le savait déjà, depuis La mort de Dante Lazarescu (2006) et 12h08 à l'est de Bucarest (2007) que :
1) La vie en Roumanie n'est pas spécialement youp lala youp la boum ni drôle à se taper sur les cuisses
2) Nous arrivent de là-bas d'excellentes choses (le "renouveau roumain", car, jusque là, l'ami Lucian Pintilié devait commencer à se sentir un p'tit peu seul)
Et ce nouvel opus, couronné à Cannes de la Palme d'Or (ce qui, autant le jour du palmarès que celui du visionnement du film de par chez nous, provoqua quelques discussions : la mérite... la mérite pas... ) vient donc doublement confirmer les deux postulats ci-dessus, en enfonçant même encore un peu, si possible, le clou de la désespérance blafarde (ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi noué pendant tout un film), qu'il double, pourtant, d'une imperceptible distance.
Comme ses copains Christi Puiu et Corneliu Porumboiu, Christan Mungiu (devinette : comment reconnait-on un nouveau cinéaste roumain ?) a tourné, comme on dit pudiquement avec peu de moyens (traduisez : des bouts de ficelle, des clopinettes, trois francs six sous) ce film noir (très sombre, en tout cas) qu'il sous-titre ironiquement (au générique de fin) Chroniques de l'âge d'or. (L'unité de temps semble aussi une composante primordiale dans ces "nouveaux films roumains" : une nuit pour Dante Lazarescu, une journée pour 12h08..., et à nouveau une journée (particulière, mais somme toute ordinaire) pour celui-ci, qui nous fera passer progressivement du clair du matin joliet au très obscur de la plus sombre des nuits.
A ceux qui seraient tenter de résumer le film par "c'est l'histoire d'une étudiante qui va subir un avortement clandestin", je dirais "c'est plutôt l'histoire de la copine d'une étudiante qui va subir un avortement clandestin", tant le personnage d'Otilia (Anamaria Marinca, magnifique) est immédiatement central, véritable pierre angulaire du film qui supporte tout le poids de l'édifice (cinématographique) sur des épaules qu'elle a aussi frêles que jolies.
On peut être désarçonné, au début, par la complexité de la situation initiale qui se dévoile progressivement (on est où ? qui est qui ? et elle pourquoi elle fait ça ? et pourquoi toujours des Kent ?) dans ce bâtiment universitaire, dans cette chambre tristouillasse (mais le bâtiment ne l'est pas moins) où il est question de préparatifs, d'argent, de marché noir, de cigarettes, de toile cirée... C'est Gabita qui doit avorter, mais c'est Otilia qui s'occupe de tout, et c'est elle que la caméra d'ailleurs se met à suivre obstinément (passionnément ? )pour ne plus la lâcher, reléguant un peu la copine en fond de scène (en off).
On passera de cette chambre universitaire à une autre, d'hôtel cette fois-ci, (avec un passage épique à la réception de l'hôtel en question), chambre où doit s'effectuer l'avortement, à l'issue d'une transaction plus qu'éprouvante, mais, finalement, juste tristement et réalistement humaine pourrait-on dire, dont le protagoniste s'appelle Monsieur Bébé... L'impossible Monsieur Bébé (un hommage à Howard Hawks ?), plutôt l'impayable Monsieur Bébé, puisqu'il va, justement, - l'expression est ignoble mais elle est tellement juste - se payer sur la bête, et même plutôt deux fois qu'une. Beurk beurk...
La caméra continue de suivre Otilia, et va un peu aérer cette histoire, à contrepied par un huis-clos (le repas d'anniversaire de la mère de son copain) mais, durant toute cette scène, on est comme Otilia, on est là mais pas vraiment là, (pourtant on aurait de quoi réagir, à l'écoute des conversations de ces "nantis" roumains...), on s'interroge, on s'inquiète, on est noué de ne pas savoir... et on finit par y retourner, dans cette chambre d'hôtel, sans même pouvoir manger la meringue que la maman du copain avait préparée spécialement pour vous et le dessert, mais en ayant eu le temps de s'expliquer un peu entre quatre-z-yeux avec le copain en se lançant au visage deux trois choses un peu amères.
La dernière partie, enfin, après l'avortement et le retour d'Otilia à l'hôtel, (et un passage dans la salle de bains qui me fut un peu difficile) sera une longue déambulation (une course plutôt), fiévreuse et inquiète, dans la nuit bucaresque, (c'est peut-être beau une ville la nuit, mais celle-là pas tellement je vous assure), la caméra (à l'épaule), traque, furète, accompagne, cette demoiselle blonde, parfois dans l'obscurité si quasi-complète qu'elle rend la scène presque abstraite. Pour finir ex abrupto par une scène assez croquignolette dans le restaurant de l'hôtel et un ultime plan cut comme une paire de claques. Pif paf! Et envoyez le musique! (la seule qu'on entendra d'ailleurs, de tout le film!)
Pour revenir à cette distance, j'ai vu le film, et c'est assez rare pour être ici noté, dans un espèce de dédoublement : sur le plan humain, affectif, mon premier degré habituel m'a fait, je l'ai déjà dit, être très très tendu pendant tout le film, tandis que d'un point de vue intellectuel, j'étais beaucoup plus détaché, appréciant ici le cadrage, là admirant tel plan particulièrement réussi, ricanant presque à certain autre moment en me disant "il a osé...", me questionnant sur le choix de l'angle de prise de vue, bref, l'image la plus proche serait celle d'un double vitrage, avec ce mince espace entre les deux parois, qui fait que l'image qu'on perçoit est légérement brouillée, dédoublée, modifiée ; c'est en même temps la réalité et pas tout à fait.
Oui, où il serait peut-être question de dualité, où le cinéaste serait comme un prestidigitateur nous disant attention regardez bien là, le chapeau, le petit lapin va sortir, mais en réalité ce n'est pas là qu'il faudrait regarder pour découvrir le subterfuge en train de se dérouler. Mungiu se défend d'avoir voulu faire un film sur l'avortement (ni pour ni contre, bien au contraire...) et c'est vrai qu'en faisant ce petit pas de côté, en (dés)axant davantage le récit sur tout ce qui est autour (l'avant, l'après, l'ailleurs...) il gagne en force ce qu'il perd en compassion. Avec l'extrême élégance de ne pas faire de Gabita une sainte laïque auréolée du prestige des martyrs, crucifiée sur son lit de douleurs (au contraire, il en rajouterait presque dans le côté nunuche agaçante, avec son accumulation de mensonges et d'indécisions), ni d'Otilia un bloc de certitudes et d'efficacité, genre "Super Bonne Copine vole à ton secours, attention ça va cartonner!" , non c'est juste une jeune femme qui marche dans la nuit, qui a peur, qui cherche, qui se demande, qui doute, une femme qui se construit, peut-être aussi...
C'est drôle (enfin, façon de parler) certains placent ce film du côté de Rosetta et des frères Dardenne, moi je le rangerais plutôt du côté de Kaurismaki : pas de paupérisme ni de misérabilisme, non, des faits, (le manque d'argent, le flicage, le marché noir, le communisme totalitairement si délicieux), juste un genre de constat, sec comme un coup de trique mais éminemment cinématographique, avec des choix affirmés de mise en scène, le tout sous-tendu par un genre d'humour froid au trente-sixième degré, prenant par cette "ironie" du regard le minimal recul nécessaire. Un certain sens de la nuance. Ca se présenterait presque comme un documentaire mais ça serait presque une fiction, ça aurait presque l'air improvisé mais ça serait très écrit, ça serait presque un drame mais à la fin on sourirait presque...
Et enfin, au générique, sur fond de musique roumaine de bal du samedi soir, le poids qu'on avait sur l'estomac soudain un peu se désagrège, tandis que les lumières se rallument. (J'avais une vachement plus belle phrase pour conclure, mais, whoof! elle s'est envolée. Tant pis pour moi (et pour vous)! Noir.)




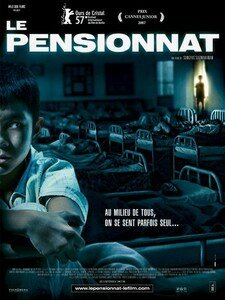







/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)