079
089
UN COUTEAU DANS LE COEUR
de Yann Gonzalez
On en a parlé au moment de Cannes, où il figurait dans la sélection française, avec des critiques plutôt très tranchées (ceux qui adorent ici et ceux qui détestent là) puis on a vu Vanessa Paradis et Nicolas Maury plusieurs fois en promo (très bien), et voilà qu'il est sorti au Victor Hugo en sortie nationale, mais avec séances irrégulières, (ce qui n'est pas très bon signe) bien avant le bôô cinéma (où on le verra -au mieux- dans la programmation estivale...)
Nous étions 4 donc, à la séance de 13h30 (et plus que 3 à la sortie, il faut le dire). J'avais adoré, du même réalisateur, Les rencontres d'après Minuit (avec, notamment, un Nicolas Maury d'anthologie, un des personnages les plus troublants que j'ai vu depuis longtemps), et j'ai pu récemment voir -ou revoir- ses courts-métrages grâce à Uncut, et donc j'étais impatient, surtout après l'enthousiasme qu'avait manifesté Hervé, de retour de Cannes, pour ce film.
Un couteau dans le coeur se revendique film de genre(s), et justement c'était plutôt drôle de le voir juste après les bandes-annonces pour la reprise estivale de cinq films de Dario Argento (dont Suspiria), plus celle des Frissons de l'angoisse (en resortie copie neuve aussi), films auxquels plusieurs plans ou ambiances ou scènes ou idées de scénario ou de mise en scène du film font explicitement référence, ou clin d'oeil, clic clic).
Une réalisatrice de pornos gay (Vanessa Paradis, blondie) -on est à la fin des années 70- est plaquée par sa monteuse (Kate Moran, de tous les films de Yann Gonzalez), et en éprouve une certaine tristesse (et colère aussi), d'autant plus qu'un mystérieux tueur au masque de cuir entreprend de trucider, avec un couteau-quéquette (ou une quéquette-couteau), les étalons de ses productions maison (dont De sperme et d'eau fraîche, qui donne son titre à ce post). Elle est secondée par un assistant pittoresque et dévoué (Nicolas Maury, blondie aussi), qui fait aussi l'acteur dans ses films maison. Et elle fait des rêves récurrents (comme dans les films de Dario Argento), en négatif, qui lui apporteront la clé de l'énigme du mystérieux tueur au masque de cuir. Elle est donc obligée de chercher en même temps à reconquérir sa copine enfuie et à démasquer le meurtrier.
C'était d'autant plus touchant, pour moi, que la scène finale ou presque se passe au Far-West, cinéma gay parisien, que je n'ai personnellement connu que quelques années plus tard, sous le nom de Far-West Vidéo Club (ou Boy je ne suis plus sûr), auquel je dois quelques brûlants et enthousiastes souvenirs de tâtonnements aussi virils que torrides (j'étais jeune...).
Le film est donc, au départ, un hommage au giallo (et je trouve cette partie-là plutôt réussie), avec un respect des codes du genre (éclairages, armes blanches, rouge sang, musique accompagnatrice et connotée, morts violentes) mais aussi au cinéma porno gay des années 70, à la marge, la frange gay, la mouvance hybride et bouillonnante de ces années-là où je découvrais avec stupeur et révissement le FHAR (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) et où je rêvais devant les petites affiches en noir et blanc dans Pariscope pour les films gays projetés à Paris et dont je me demandais si je pourrais les voir un jour (j'avais vingt ans, oui oui...)
C'est un genre de créature filmique hybride (comme les travelos qu'on suit dans le film), un film transfilm, qui serait déguisé en un autre film, ou qui voudrait nous faire croire qu'il veut se faire passer pour autre chose (la proposition est complexe, mais la matière du film l'est tout autant). Tout ça est très attachant, et la présence inattendue de guest-stars aussi référencées qu'attachantes, justement (Bertrand Mandico en chef-op', Yann Colette en flic, Jacques Nolot en aubergiste, Romane Bohringer en fille d'aubergiste, Florence Giorgetti en dame-pipi) en rajoute encore dans l'affectif.
Et c'est cet affectif là, justement, débordant, qui va réussir à faire passer outre (à enjamber, quoi) les faiblesses de la chose, certaines scènes un peu mal fagotées, ou mal jouées, ou mal montées (!), que sais-je. mais bon, à chaque fois, ça passe. (Oui, passer outre). C'est vrai que j'adore tellement le début (ce qu'on appelle, à très juste titre, un montage alterné (montage pouvant tout à fait, et c'est même recommandable, être pris -je m-enfonce- ici au sens biblique du terme) qu'ensuite il est normal que ça retombe un peu, et même que ça patauge parfois, un chouïa...) Un couteau dans le coeur est un film divinement imparfait mais parfaitement fascinant.
Yann Gonzalez aime ses personnages, tous, et nous fait partager cet amour, ce désir, cette tendresse (J'en éprouve une toute particulière, par exemple, pour le technicien dodu surnommé Bouche d'Or, qui remet les étalons d'équerre...), c'est vrai qu'on aurait pu souhaiter qu'il ait eu, idéalement, autant de tendresse à l'égard de son scénario, par exemple. Mais bon on s'en fout un peu quand même, finalement, que ça ne soit pas parfaitement parfait, parce qu'on y prend vraiment du plaisir, on regarde de tous ses yeux, on écoute de toutes ses oreilles, on est à l'affût, aux aguets, au guignol, à la fête, on frémit, on sourit, on pâlit aussi, parfois, on reprend son souffle lorsque Yann Gonzalez nous fait passer sans transition d'une scène bouillante à une autre glacée. Comme le métal en fusion dans l'eau glacée. Et on prend plaisir à cataloguer les clins d'oeil, les hommages, les citations, les interférences, et c'est plutôt jouissif, ce bonheur supplémentaire.
Un film, donc, qui divise, et qu'on aura le plaisir de vous présenter au sein de notre programmation estivale, dans le bôô cinéma...

J'y suis retourné ce vendredi avec Catherine (qui a désormais le loisir d'aller au cinéma autant qu'elle veut...), et toujours avec grand plaisir. Et mes sentiments restent les mêmes.Tout le début du film est fort, tenu, troublant, drôle, flippant, solide, haletant, rien à redire, et commence un peu à donner des signes de faiblesse (d'essoufflement) à partir de la scène du pique-nique, où le film commence un peu à perdre pied, ou à ne plus savoir sur quel pied, justement, danser. Des lézardes qui deviendraient des fissures. L'encombrement (l'entassement) des scènes finales (au Far-West) déséquilibre hélas un peu l'ensemble (pour le spectateur rationnel et tatillon), et l'ultime explication en voix-off et en noir et blanc par Kate Moran n'était franchement pas indispensable, mais heureusement la toute dernière scène (sur laquelle défile le générique) reprend du poil de la bête (et le film de la hauteur) en nous reconstruisantt un délicieux petit cinéma immaculé (séraphique et élégiaque) , in paradisum, vraiment.
Je parlais dans le premier post des apparitions référencées (Nolot, Bohringer, Mandico), j'en avais oublié une, que je n'ai reconnue qu'à la deuxième vision, il s'agit d'Ingrid Bourgoin, qui fut pour marie-Claide Treilhou une inoubliable Simone Barbès (ou la vertu), dans le film du même nom, qui apparaît en barmaid dans le cabaret lesbien (scène qui est, je pense, un clin d'oeil supplémentaire à ce même film).
Ca nous a permis d'échanger, dans le couloir, au sortir de la salle, et ça c'était vraiment agréable.







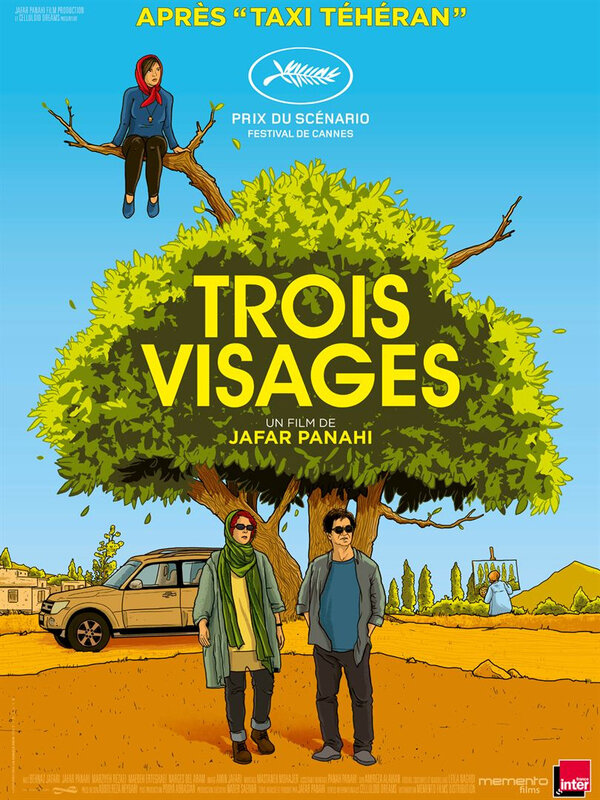

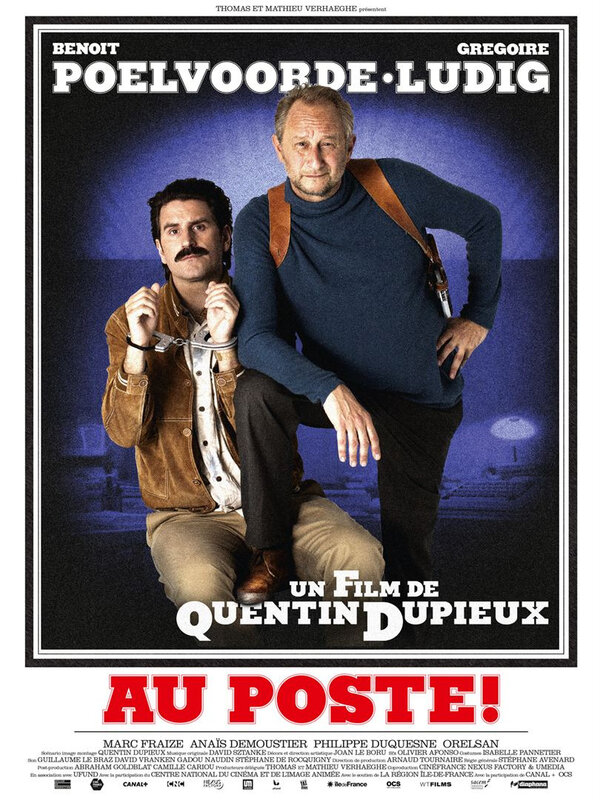
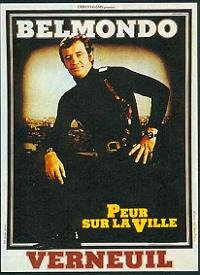


/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)