bienvenue aux lendemains
128
COLD WAR
de Pawel Pawlikowski
J'étais resté sur le souvenir de l'émerveillement produit par Ida (là), en 2014. Et j'ai donc couru voir celui-ci dès la première séance, sans en rien savoir du tout, avec les copines Emma et Dominique, dans la salle 3 de notre cher Victor-Hugo. Tranquilles, au dernier rang (pour ne pas recevoir des coups de genoux dans le dos) même si quelques vieilles sont venues en ribambelle perturber notre quiétude en voulant s'asseoir aussi en ce même dernier rang. Mais passons sur les fâcheuses.
Plastiquement, le film provoque la même sidération qu'Ida (même format, même sens du cadrage, de la composition) pour un sujet un peu différent (quoique). L'histoire est cette fois centrée sur un couple (une chanteuse blonde et un musicien brun, Joanna Kulig et Tomasz Kot, tous les deux délicieusement délicieux) du genre que je préfère, celui du "ni avec toi ni sans toi", qu'on va suivre de de 1949 (le moment de leur rencontre) jusqu'à quasiment quarante ans plus tard, quand la boucle est bouclée. En Pologne, puis à Berlin, puis en France, puis re-en Pologne. Un couple dont le réalisateur affirme que l'histoire est inspirée de celle de ses parents (à qui le film est d'ailleurs dédié).
Un film qui chante beaucoup (toutes les premières scènes, par exemple, j'en étais très étonné) et qui danse (presque) tout autant, et même qui jazze (même si, justement, vous devez commencer à le savoir, ce n'est pas là mon genre musical préféré...), et c'est drôle (et attendrissant) de voir comment les temps changent (et les lendemains qui (dé)chantent) avec l'évolution d'un chanson (celle qu'on peut appeler "Oy oy oy", qui démarre à l'ouverture du film en refrain folklorique pour choeur de vierges aux joues rouges au grand air pour finir (à la presque fin de l'histoire) en standard vinylique germanopratin (voluptueux et enfumé.)
Le réalisateur parle d'amour, mais, comme dans Ida, il parle -d'abord- de la Pologne, du communisme, de la guerre froide, de l'histoire, de la politique, c'est la trame de ce qui aurait pu être un mélodrame étriqué (convenu) mais qui par son sens de l'ellipse et par la grâce de sa mise en scène épurée (sans esbrouffe) devient une grande et belle et touchante chronique (le dernier plan est beau à tomber, et il y aurait d'ailleurs tout un beau travail à faire sur les sorties de cadre dans les films de P.Pawlikowki...) au lyrisme tenu (ténu ?). L'Amour , l'Histoire avec un grand H, mais aussi, surtout, celle d'un couple qui se forme, se déforme, se distend, s'éprend et se déprend, au fil des ans et des lieux, et des élans de chacun des deux.
Et puis ne boudons pas le plaisir de retrouver, dans la partie française, "la" Balibar (notre Jeanne -cocorico- Nationale, que je n'ai d'ailleurs pas identifié à sa toute première scène), mais, également, Cédric Khan (dont j'ai dû attendre jusqu'au générique de fin pour retrouver le nom) que j'aime décidément beaucoup comme acteur même si j'ai du mal à reconnaître.
Le film est bref (moins d'1h30, générique compris) et c'est juste parfait comme ça. On ne pourra pas l'accuser d'en faire trop.
Avec Dominique et Emma, nous sommes sortis tous trois parfaitement ravi(e)s.
Une incontestable perfection formelle (même si l'histoire est peut-être un peu en deça de celle d'Ida)
Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un oeil sur les critiques, dont j'étais certain que quelques-un(e)s allaient m'énerver. Bingo. Une fessée pour le nouvel *bs, d'habitude mieux inspiré ("Un film de misanthrope drapé dans un romantisme factice") et une pour les Cahiaîs -j'allais dire "bien sûr", tellement ils ont le don, à chaque numéro, de m'énerver plusieurs fois- ("Cold War fait partie d’une vague « rétro » fleurissant actuellement en Pologne marquée par un retour quelque peu nostalgique à la période de la guerre froide. Ce cinéma vintage met l’accent sur la reconstitution soigneuse de l’atmosphère de l’époque d’avantage que sur l’analyse politique. Le film de Pawlikowski ne déroge pas à la règle.")
Pffff...
Ah tiens, si... Si je peux me permettre, j'en aurais bien une petite, de critique : quelle idée de traduire "en français" le titre polonais original par Cold War... A mon avis, il y avait mieux à faire...











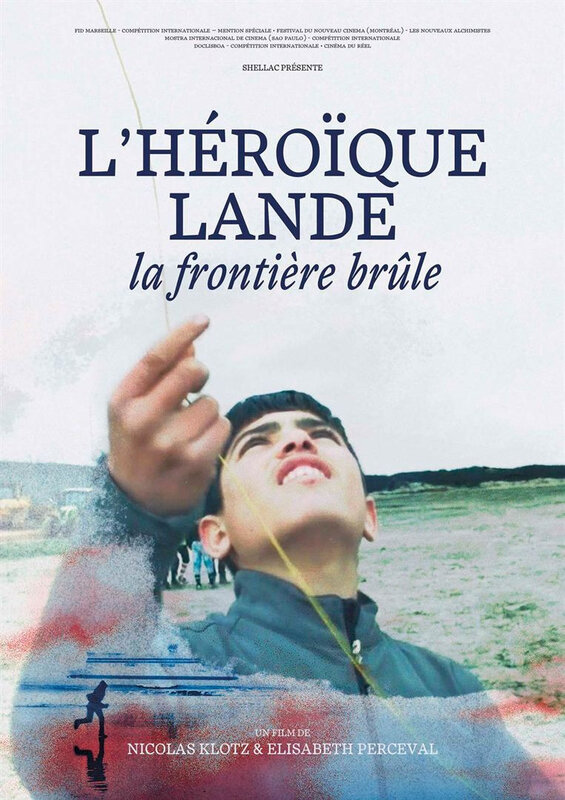
/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)