déguisée en jambon
056
DU SILENCE ET DES OMBRES
de Robert Mulligan
Bien plus que celui de Un été 42, Robert Mulligan reste pour moi le réalisateur du terrifiant L'Autre (et je m'aperçois en lisant sa filmo sur allocinoche que je ne connais quasiment rien d'autre de sa pourtant conséquente filmographie) dont je vous mettrai l'affiche plus bas, parce que je l'ai toujours gardée et qu'elle me fascine.
L'autre, c'était une histoire de gamins, et je n'étais donc pas dépaysé au début de ce film : c'est l'histoire de Scout et Gem, un frère et une soeur, pendant les vacances, dans les années 30, juste après "la grande dépression). Deux gamins qui jouent, en compagnie d'un jeune voisin, à des jeux de gamins, des jeux qui font un peu (délicieusement) peur, et la façon qu'a le réalisateur de jouer sur les frayeurs enfantines (avec une ombre ou une simple balancelle) est proprement magnifique.
Ces deux enfants ont pour père Atticus, un homme idéal, humaniste, attentionné, bienveillant (Gregory Peck, beaucoup plus rassurant que dans La maison du Dr Edwardes). C'est un avocat, qui va être chargé de la défense d'un jeune noir accusé de viol et de meurtre (sur la personne d'une femme blanche). La première partie du film est centrée sur les enfants, puis une longue partie suivante au procès, avant de revenir sur le enfants (une soirée d'Halloween spécialement mouvementée) et de se clore sur un final familial et plein de douceur, qui m'a alors allez savoir pour quoi (les enfants ? le noir et blanc ? l'agression ?) un peu fait penser à La Nuit du Chasseur, où un Gregory Peck aurait remplacé Lilian Gish (qui elle, montait la garde vaillamment, et défendait avec son fusil les deux enfants contre le Mal).
Le film est l'adaptation d'un livre célébrissime aux Etats-Unis, To kill a mocking bird, de Harper Lee, un livre largement autobiographique dont la voix-off de la narratrice est d'ailleurs est conservée, qui ouvre (et referme) le film. La copie restaurée est magnifique, et on prend grand plaisir à cette histoire (à ces histoires : le procès pour les adultes et la maison du voisin pour les enfants), pqui dégage un charme indéniable (que certains qualifieront de suranné) beaucoup plus sensible pour moi dans les parties consacrées aux enfants (le début et la fin) que dans celle du procès. La description de la ségrégation raciale en Alabama dans ces années-là fait froid dans le dos mais il suffit de regarder un peu autour de nous, maintenant, pas très loin pour se dire que non non rien n'a changé. Et qu'un plaidoyer anti-raciste, aussi idéaliste soit-il, est toujours bon à prendre.
Un sacré beau film, que je méconnaissais complètement, et pour lequel je dois remercier, donc, le Festival Play it again...
une ancienne
une autre ancienne
une encore, españole
et une dernière, qui ne raconte pas du tout la même chose...














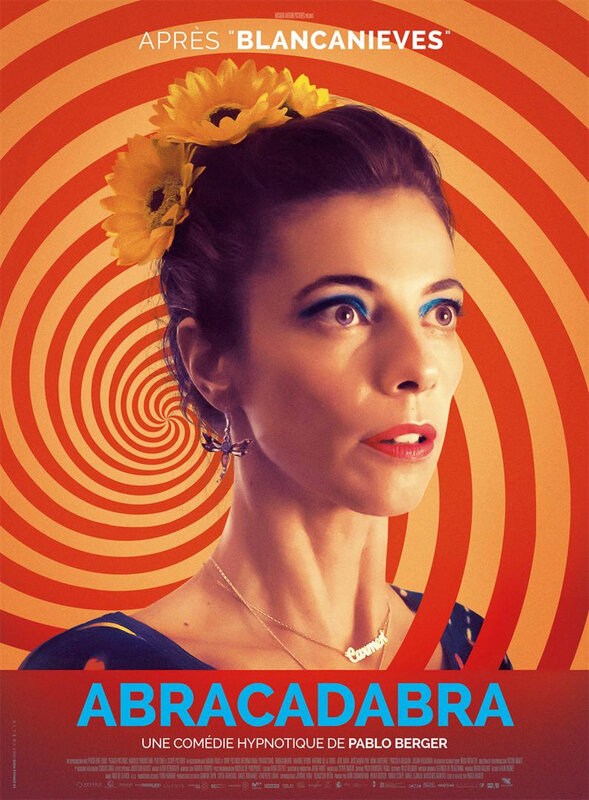




/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)