
176
LE VEUF
de Dino Risi
Premier film vu de La Quarta Settimana Italiana qui débute aujourd'hui (et qui m'aura causé alcuni problemi). Un film de 1957, dirigé par Dino Risi, autour d'un Alberto Sordi impeccable de veulerie. Le film a été restauré, la copie est impeccable et Alberto Sorti est grandissime. Dino Risi nous faisait déjà rire jaune : Un quasi-aigrefin sans le sou a épousé une richissime et jongle avec ses créanciers, jusqu'à ce qu'on annonce la mort de ladite épouse dans un accident de train. Le veuf se croit riche, et change de statut et de comportement, jusqu'à ce que... Si le récit est assez prévisible (les deux-tiers en sont d'ailleurs racontés dans la bande-annonce, et le tiers restant n'est pas le plus palpitant...) le film vaut, bien sûr par l'abattage de notre Alberto (auquel est d'ailleurs rendu, cette année, un hommage avec deux films). Qui en fait des caisses,certes, mais des caisses géniales, alors, on lui pardonne tout...
*

177
L'ULTIMA SPIAGGIA
de Thanos Anastopoulos et davide Del Degan
QSI 2 : un documentaire fort attendu (je l'avais déjà souhaité pour la précédente édition, mais il était alors de trop fraîche date sorti). Deux heures ritalissimi, mais en maillot de bain. La plage du Pedocin, à Trieste, qui a la particularité d'être coupé en deux par un mur, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Une plage payante, avec deux guichets et deux entrées. Et les gens qui sont sur la plage, depuis le début de la journée jusqu'à l'heure de la fermeture (19h30). Un documentaire simple et touchant, attentif, attendri, les gens, la vie quoi, les discussions, les rigolades, les chansons, les disputes, et les petites histoires du quotidien : le composteur de tickets coincé, un cadenas sur un transat pour le réserver, les toilettes qui se bouchent, un maître-nageur serbe, la mort d'une femme de ménage, de quoi alimenter les conversations des autochtones (i locali). Etre et avoir, été.
*

178
UN PAESE DI CALABRIA
de Shu Aiello et Catherina Catella
QSI 3 : le deuxième doc, celui-ci aussi très attendu. Un film qui démarre piano piano, un peu confusément, mais se construit progressivement, et accueille le spectateur à bras grands ouverts, comme les derniers habitants de Riace l'ont fait avec les 200 kurdes débarqués un beau matin sur la plage... La première voix du film est en français (celle d'une émigrée vers la France), la seconde, en italien, est celle d'un de ces kurdes, justement, qui explique comment il est arrivé là et n'en est plus jamais reparti. Un film optimiste, un film qui fait du bien, qui redonnerait presque foi en l'humanité (comme disait Claude W. à la sortie "C'est pourtant pas compliqué..."), entre "Si tous les gars du monde..." et "Tous ensemble, tous ensemble!". Ça réchauffe et ça fait du bien... (notamment une jolie scène avec les Saints Côme et Damien)
*

179
A CIAMBRA
de Jonas Carpignano
QSI 4 : Hervé m'avait prévenu de la similitude avec La BM du Seigneur, et je n'ai donc pas été étonné lorsqu'au générique de fin, autour de Pio Amato, l'interprète du personnage principal, l'écran s'est ensuite entièrement rempli avec le nom de tous les autres Amato de la famille, qui jouent leur propre rôle... Un film réaliste, âpre, "rugueux", sur la vie d'une famille rom (en vo "zingari") où un gamin de 13 ans veut qu'on arrête de le considérer comme un môme et veut devenir un homme, ou du moins qu'on le reconnaisse comme tel. (et, coïncidence ,tiens, une nouvelle référence aux saints Côme et Damien). Je dis, à la sortie, "Dommage qu'il faille faire une saloperie pour devenir un homme" mais Zabetta corrige "Il a choisi de rester fidèle à sa famille..." Dur dur, quand même
*
180
PROFESSION : MAGLIARI
de Francesco Rosi
QSI 5 : Le deuxième film de l'hommage à Sordi, sorti la même année que Le veuf. Un beau noir et blanc, des italiens émigrés à Hambourg (il fait froid), qui traficotent pour s'en sortir, du jazz dans la bande-son BEAUCOUP TROP FORT encore une fois, je gueule, oui, c'est exprès), un Sordi égal à lui même (Albertissime), et un Renato Salvatori débutant qui joue les pieds-tendes à coeur d'artichaut. Dès le début, j'ai senti hélas que je papillonnais, et si à un moment Hervé ne m'avait pas dit "Tu dors ?", me réveillant en sursaut, je crois que j'y serais encore (en train de dormir). Du tout je n'ai pas tout compris à cette histoire de tissus et de tapis. Pas un sommeil hostile pourtant, mais un film longuet, qui a un peu vieilli... Une curiosité en tout cas, et une découverte : Alberto Sordi n'a pas tourné que des comédies...














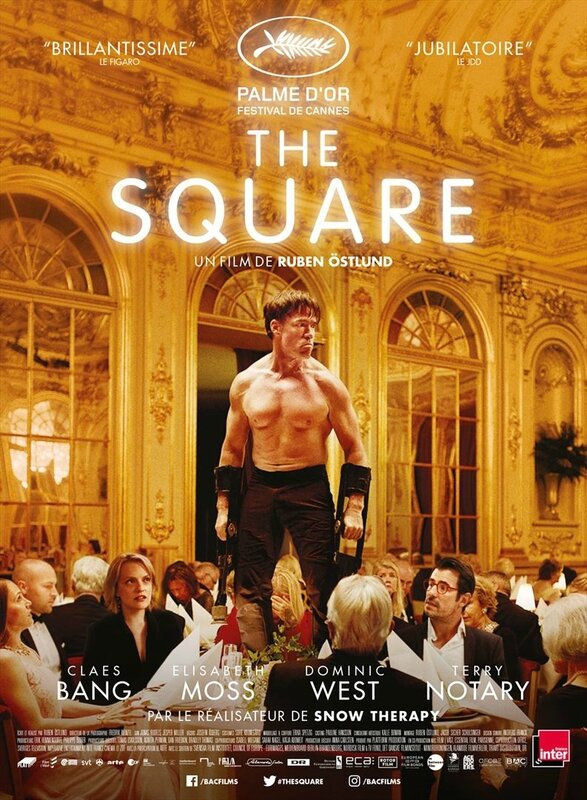






/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)