Ich habe genug
001
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
de Karim Moussaoui
C'est bien de commencer l'année-ciné avec un beau film comme ça. Bon, il ne passe que trois fois, il fallait donc s'organiser, et j'étais content de voir qu'il y avait pas mal de monde dans la salle, à cette séance de 20h30 un dimanche soir dans le bôô cinéma... Un (premier) film algérien assez bluffant : on va y suivre trois histoires, consécutives, qui n'auront aucun rapport entre elles sinon par leur effet de transition (où, à chaque fois, il sera question de voiture et de déplacement). Trois récits prenant place dans le même pays, l'Algérie, qu'on n'a pas l'habitude de voir ainsi filmée, à mi-chemin entre le craspec' de la réalité des bidonvilles et des déchets et le yrisme grandiose des paysages.
Karim Moussaoui (avec l'aide de Maud Ameline -c'est rare que je puisse me vanter d'avoir déjà vu "en vrai" une scénariste et pourtant c'est le cas) nous parle d'une réalité algéroise, d'un quotidien "concret" au fil de trois récits : celui du promoteur témoin d'un tabassage violent mais qui n'ose pas intervenir, celui d'un chauffeur obligé de passer une nuit à l'hôtel en compagnie de la jeune fille qu'il transporte vers son mariage, et, enfin, celui d'un médecin, lui aussi sur le point de se marier, mais soudain confronté à la réapparition d'une "histoire" de son passé. Avec, en cadeau, ce qui pourrait être comme le début d'une quatrième histoire...
Et c'est filmé magnifiquement.
Très simplement mais avec ce petit quelque chose en plus (j'ai pensé au magnifique Rome plutôt que vous, de Tariq Teguia, mais, aussi, dans une moindre mesure, au nerveux C'est eux les chiens d'Hicham Lasri, sans oublier le sublime - et "matriciel" Bled Number One, de .Rabah Ameur-Zaïmeche, tous trois programmés en leur temps et par nos soins dans le bôô cinéma) qui vient comme transfigurer l'histoire. C'est à la fois une façon de regarder les événements (et la façon dont les personnages s'y inscrivent) et aussi de les structurer (les événements), de les mettre en jeu, parfois simplement en bougeant juste la caméra un poil vers la droite (la scène de comédie musicale qui nait soudain dans le désert). Le réalisateur met simplement en scène des personnages qui vivent simplement leur(s) histoire(s) mais la façon dont il le fait nous suggère qu'il en raconte beaucoup plus que ce qu'il a l'air de vouloir dire.
Il est question de famille, de traditions, de pouvoir, de corruption, de la guerre aussi, sans que jamais le spectateur ait la sensation d'empilement, de volonté de démonstration, d'insistance démonstratrice, et c'est ce qui fait la délicatesse, la légèreté (et, pourtant, la force) du cinéma de Messaoui.
Et l'utilisation magnifiquement intelligente de la musique dans le film (les plus beau moment étant, pour moi, bien sûr, dans la deuxième histoire, la façon dont la musique de Bach vient se superposer à (et remplacer) une musique de danse, pour accompagner la plus tendre -et muette- des scènes, devant la porte de la chambre de la jeune fille).
Symboliquement, c'est important de mettre ce premier film de l'année dans un top quelque chose à venir. Comme une première pierre.

Et merci aux copines qui m'ont donné une petite leçon sur les subtilités de la langue germanique, le Ich habe genug du titre de ce post (et du morceau de Bach) pouvant se traduire -au choix- par "Je suis comblé(e)" ou "J'en ai assez!" -au sens de ras-le bol!. Malin!




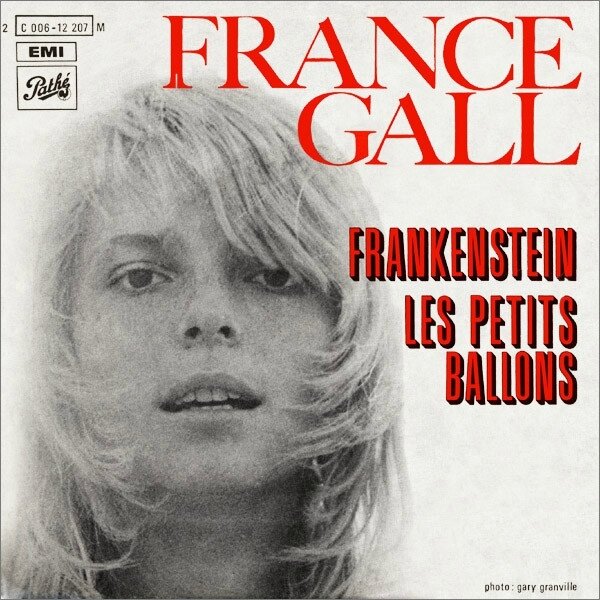







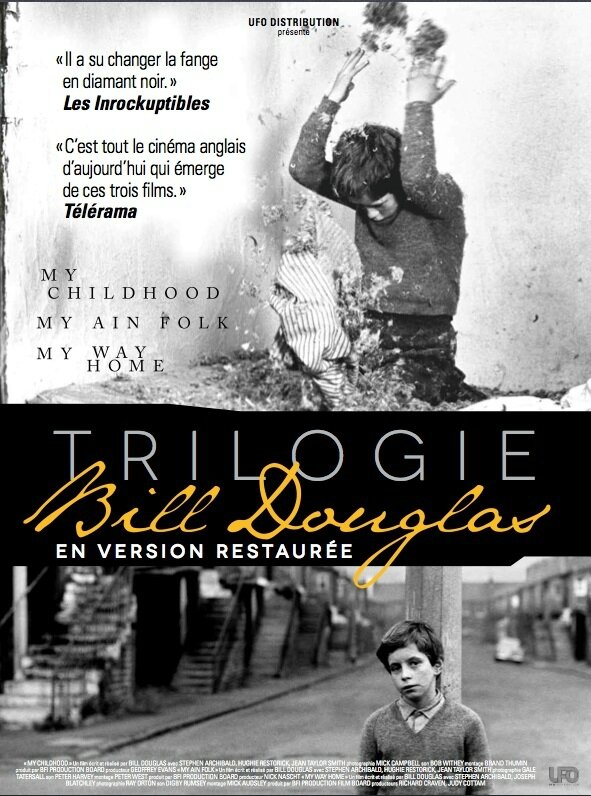
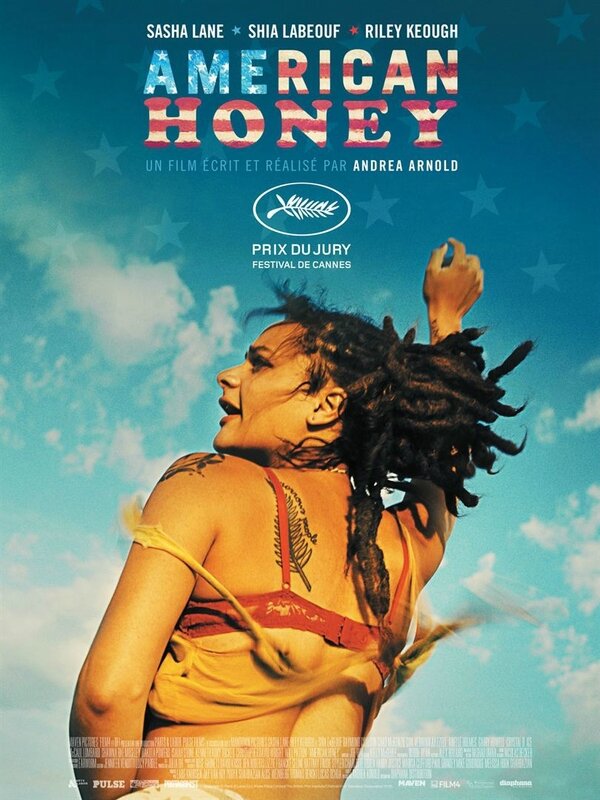







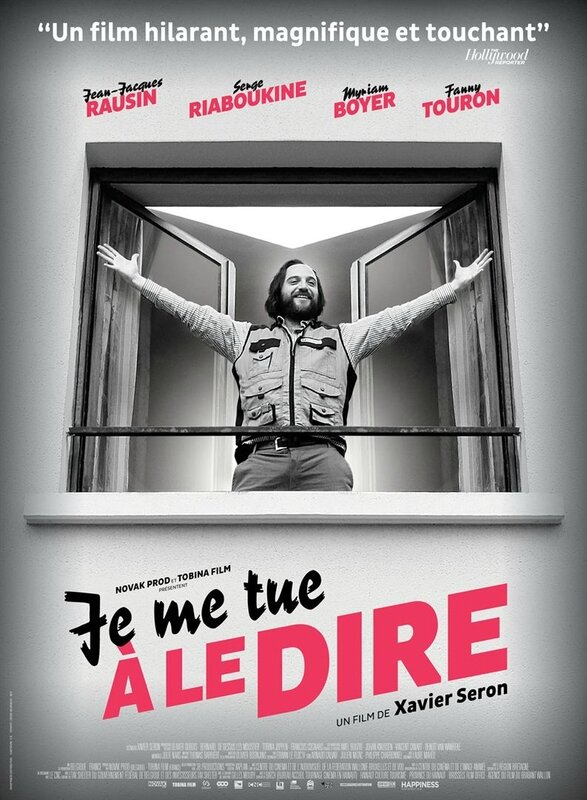

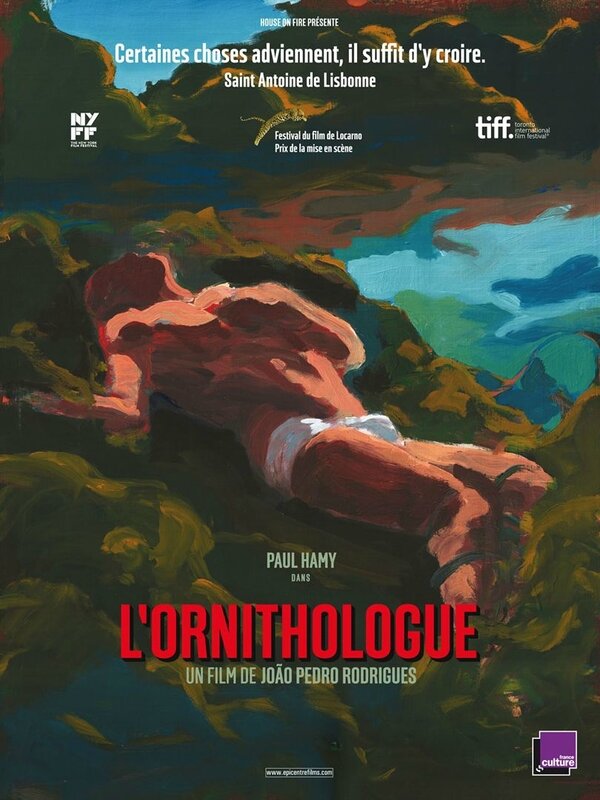
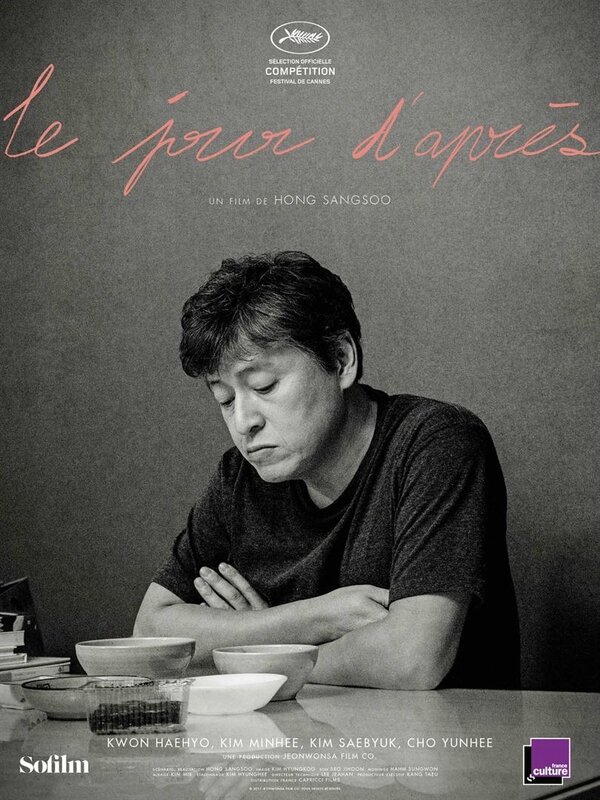
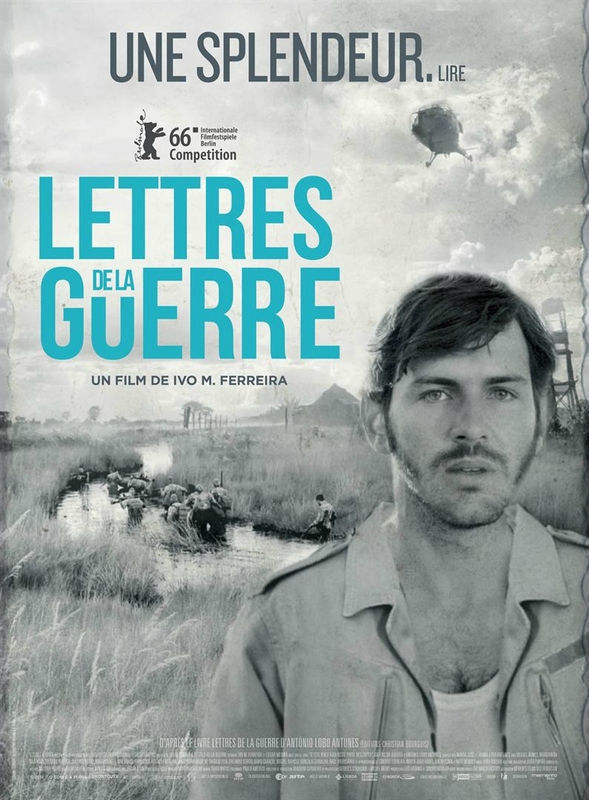
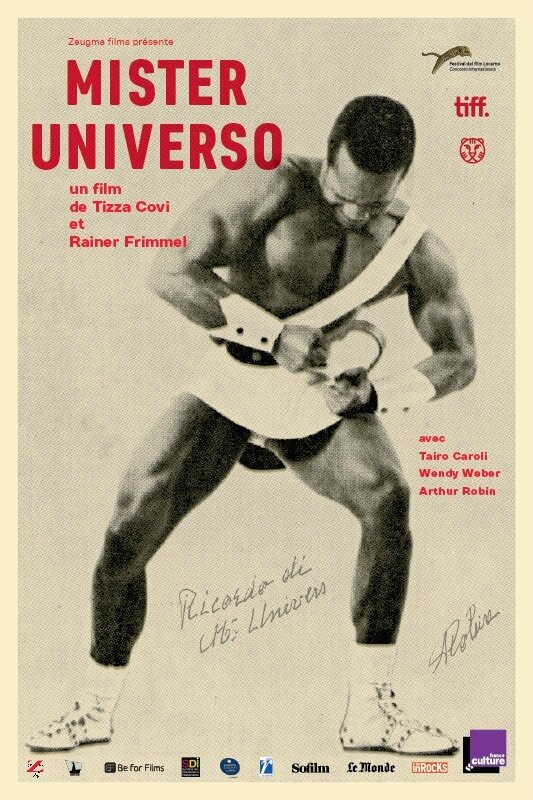












/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)