jus de raisin (des français)
078
RETOUR A BOLLENE
de Saïd Hamich
J'ai attendu la Teuf du Ciné pour aller voir ce film de notre programmation (un euro de moins, hein, c'est toujours ça...) et je l'ai donc vu dans une salle inhabituellement remplie (mais ça, ça faisait plutôt plaisir).
Un film ramassé (1h15), sec, tendu, autour d'un fils, prénommé Nassim, ayant quitté sa famille pour aller travailler à Abu Dhabi, et décidant soudain de revenir les voir, (pour leur présenter sa fiancée ?), en France, à Bollène plus précisément, où il a passé son enfance, et où sont restés tous les siens.
Il revient sur des lieux qu'il a quittés (qu'il a fuis) depuis longtemps, et va devoir se confronter à son passé. Il passe voir son frère, ses soeurs, sa mère, mais refuse obstinément de rencontrer son père, avec lequel on comprend qu'il est fâché depuis un certain longtemps, sans espoir de rémission (de pardon). Nassim voit beaucoup de monde, donc, échange sur la religion, le respect du Coran, le chômage, les petits boulots, les petits trafics, la fumette, le rap, l'extrême-droite et les fascistes, les gâteaux faits maison de sa mère... C'est passionnant, jamais théorique ou systématique.
On observe, en même temps que Nassim, la situation catastrophique (pathétique) de la ville et de ses habitants.
Nassim est joué par Anas El Baz, un acteur imposant, impressionnant, à double visage pourrait-on dire, puisque le réalisateur nous le présente d'abord sous bon profil droit (son "bon" profil) avant qu'un plan suivant ne nous face découvrir son profil gauche, et de découvrir qu'il a quelque chose (peut-être un accident, qui a laissé des traces) au niveau de l'oeil et de l'arcade sourcilière, et nous le rend, du coup, encore bien plus attachant.
Le film aborde les problèmes, comme nassim, assez frontalement et poursuit vers sa destination (enfin, celle que le spectateur envisage), qu'il atteindra dans une scène qu'on aurait pu craindre climaxique (celle de la rencontre avec le père) mais qui reste, curieusement, assez dépassionnée, traitée à juste distance, au mileu d'une serre, un couteau à la main, mais juste pour cueillir des salades. Un genre de Du passé faisons table rase de notre héros. une rencontre qui ne changera finalement pas grand chose pour Nassim (ni pour son père d'ailleurs).
Et on se quittera sur cette scène magnifique (oui, qui justifie à elle-seule de voir le film) où Nassim, seul dans sa bagnole, enregistre un message téléphonique pour sa copine, qui est repartie, message où il se "déboutonne" et se laisse aller. puis l'efface et en enregistre un autre, moins touchant. Qu'il efface à son tour pour en enregistrer un troisième bien plus neutre, où il a reboutonné sa cuirasse.
Très fort.
Top 10, sans doute.






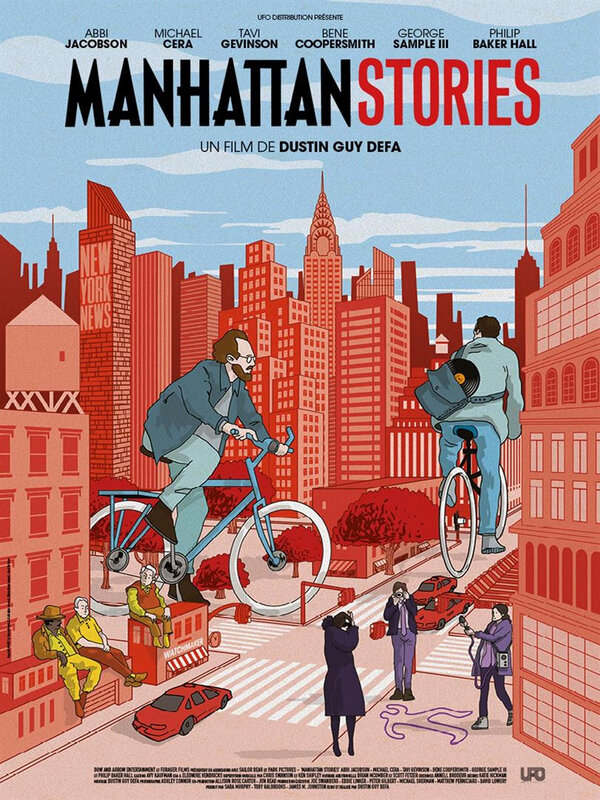
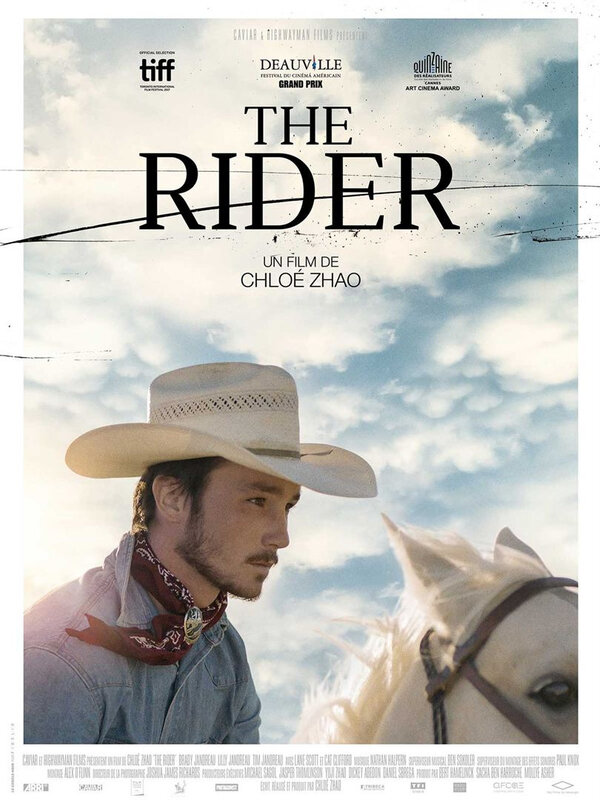





/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)