IL EST DIFFICILE D'ËTRE UN DIEU
d'Alexei Guerman
D'habitude je suis assis au fond, en bord de rang, mais il y a certains films pour lesquels j'ai besoin d'être au milieu de la salle, "au croisement des diagonales", pour mieux m'y mettre en immersion (dans les derniers : Ne change pas, de Pedro Costa, Leviathan, de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, Faust de Sokourov). Celui-là, je l'avais en ligne de mire, depuis que je l'avais raté à l'Etrange Festival (mais comme il était ensuite, bien avant sa sortie officielle, apparu -plop!- sur le web, j'avais pu en voir le début, sur mon ordi, avant de décider que cette prolifération marécageuse avait besoin d'être vue sur grand écran.) Il est programmé cette semaine dans le bôô cinéma, pour deux rikiki séances (dont une le mercredi soir, alors qu'on ne passe JAMAIS de nos films le mercredi soir) et nous étions donc 3 dans la salle au début -je pense que je devais être plus âgé que les deux autres spectateurs réunis-, mais ne fûmes plus que deux à la fin.
2h50, noir et blanc, russe sous-titré, tout pour attirer le chaland! Et le film tient effectivement ses promesses. Le "résumé" évoque une planète comparable à la Terre, où des terriens ont été envoyés en observateurs. Une planète qui est restée coincée au Moyen-Âge. Et n'a pas l'air d'être prête d'en sortir. Les terriens observent mais n'ont pas le droit d'intervenir sur le cours des événements. On a donc la voix-off du narrateur/observateur, et ce qu'il voit (la caméra). C'est un des rares films (avec Le voyeur, de Powell) où la caméra existe en vrai pour les personnages du film, où on la regarde, où on s'approche pour la toucher, ou la sentir (c'est un film très sensoriel), où on la prend à parti, où on la provoque en agitant devant son oeil impassible (impavide) des machins divers. Face à la caméra, il y a un grand barbu qu'on va suivre sans arrêt, le Don quelque chose, qui parle aussi sans arrêt. Une sorte de seigneur qui est pris pour un dieu par la population locale -et quelle population, une sorte de cour des miracles, une galerie de trognes, sales, déformées, édentées- qui vaque à ses petites affaires moyen-âgeuses, qui grouille, qui s'affaire, qui s'agite, au milieu de la fange, de la merde, de la gouillasse...
C'est un film insensé.
C'est un film inracontable, incompréhensible (Pourrait-on raconter, ou expliquer, une fourmilière, ou une termitière, en faisant des très gros plans sur l'activité de certaines des bestioles qui l'habitent ? Pourrait-on comprendre, ou au moins appréhender une globalité sociale en n'en observant que des détails ?) Un flot d'images, et de mots (et la lecture des sous-titres en rajoute aussi à sa façon dans la difficulté d'appréhension -et de compréhension- de cet univers) perpétuel : l'écran est plein à ras-bord, toujours (on comprend que le tournage du film ait duré des lustres) pendant que le seigneur parle, ou commente, ou apostrophe, ou monologue, ou insulte, tout en faisant d'autres choses qui ne sont pas forcément raccord avec ce qu'il dit. Avec constance, obstination, la logorrhée accompagne la saturation visuelle. On est pris, captif plutôt (et il ne fait pas bon être prisonnier sur cette planète, vu la façon dont il les traitent... Noyé dans les latrines, ça vous dirait ?), il s'agit alors de tenter d'accommoder, d'être perpétuellement en alerte, les yeux et les oreilles grand ouverts (pas le nez, heureusement, le film n'est pas en odorama) pour tenter de -un peu- comprendre, de combiner les éléments disparates pour faire- un peu- sens.
C'est un film total, un film-somme, un film-univers (je parlais d'immersion au début du post et le mot est ici tout à fait justifié). Un film qui déconcerte, déstabilise, dégoûte même, (parfois, souvent) un film qui dégueule, qui chie, qui suppure, qui pue, un film de trou-du-cul-du-monde, un film organique, sphinctérien, un film d'entrailles, de sang, de merde. Métaphore physique, géographique, anatomique, mélancolique, boulimique, d'une certaine russitude (on ne peut pas ne pas penser à Stalker, d'après les mêmes Strougatski -pour le bouquin- mais avec Tarkovski derrière la caméra : même humidité, même fange, même désespoir).
Guerman a passé plus d'une dizaine d'années sur ce projet, et n'a pu vraiment en venir à bout (car il est mort. ) Et c'est sa femme et son filston qui en ont achevé le montage. (D'où la pensée que le film n'est peut-être pas que d'Alexei Guerman (qui n'a réalisé que six films mais dont aucun n'est trouvable -par des moyens "normaux"... -J'ai le bonheur d'être en position d'un exemplaire de Khroustaliov ma voiture! -enregistré sur VHS lors de son passage sur arte il ya longtemps, et numérisé ensuite, mais bon la qualité est celle de la VHS- autre film insensé en noir et blanc et en russe sous-titré, que nous avions programmé lors de nos -éphémères- "lundis des amis", dans l'ancêtre -un peu guermanien, d'ailleurs- du bôô cinéma, c'était plutôt alors le môôôche cinéma, d'ailleurs!) ou plutôt n'est pas tout à fait le film que Guerman "tout seul" aurait fait, mais au fond quelle importance ?)
Un film, donc, qui refuse le "récit" traditionnel, la narration "habituelle" : plutôt que d'aller de l'avant on a l'impression que le récit glisse latéralement, comme un travelling gigantesque, et peut-être circulaire, d'ailleurs, comme si aller de l'avant était impossible, inimaginable, proprement (!) impensable.
Un film viscéral.
Un film éprouvant.
Et aussi, un film qui, à force de coller ses yeux (et son nez) tout près, trop près, ("le nez dedans") finit pourtant par mettre le spectateur à distance. Le spectateur qui n'a pas grand chose de connu à quoi se raccrocher, qui patauge, et avance prudemment en essayant de ne pas s'en foutre partout. Rester debout, rester vivant. (rester éveillé, aussi, diront les mauvaises langues : j'avoue que j'y ai piqué du nez, et, même, dans cet état, mi-sommeil mi-éveil, le film a quelque chose d'hypnotiquement monstrueux : cette voix dont on ne comprend plus les mots (si on ferme les yeux, on n'entend que le russe) qui vous ferraille dans l'oreille sans trêve, infiniment...) Le temps n'a plus de sens.
Un film sans précédent, comme une gigantesque boucle temporelle, une stase.
Il n'y a qu'à la fin que le réalisateur nous sort la tête du caca et des tripes et prend un peu de recul. Et modifie - enfin ?- notre regard, (et donc notre rapport au film). La caméra a pris de la distance (elle n'est d'ailleurs à ce moment-là plus utilisée en tant que personnage, c'est juste une caméra, qui enregistre ce que font des gens). La scène où le Don, en chemise, le cul dans l'eau, explique aux autres qu'il ne reviendra pas sur terre.(J'avoue, je viens de la re-regarder sur mon ordi, et ça m'a permis de comprendre certaines choses. D'abord de mieux appréhender l'invraisemblable complexité -la virtuosité- de ces plans-séquences démesurés, où se combinent les mouvements de caméra, ceux des personnages, la profondeur de champ). A ce moment, après cette halte, cette respiration, (l'homme, toujours le cul dans l'eau, vient de s'endormir) la caméra reprend soudain son rôle initial, celui de personnage au même titre que les autres, puisque c'est à ce moment que le Don se rhabille, remet son costume de Don pour repartir... (la scène est absolument magnifique).
Puis la caméra prend -enfin- le temps, de la distance aussi, sur de splendides perspectives de neige (et de silence), qui laissent au spectateur le temps de respirer, de se reprendre, avant un sublime plan final où le film enfin s'apaiserait (si Le cheval de Turin virait au dark, à l'obscurité, aux ténébres, ce film-ci, au contraire, en sort, in extremis, et réussit finalement à nous tirer vers le blanc, sans que les perspectives d'avenir en soient plus joyeuses...), prendrait le temps de nous laisser le quitter, avant un austère (et démesuré) générique de fin.
C'est incontestablement le genre de film qu'il faut avoir chez soi, qu'il faut garder (et re-garder). Pour prendre le temps de. (L'arrêt sur image et le rewind sont des fonctions divines, quand il s'agit de mieux comprendre cet univers-là et de l'appréhender à sa juste mesure.)




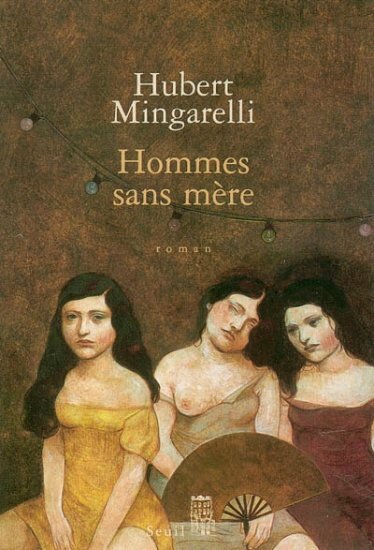







/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)