lundi 15
arrivé à midi
Alissa a fait une tarte poireaux jambons sans gluten délicieuse
après je pars au cinéma :
CASA GRANDE
de Felipe Barbosa
****
Une solide chronique sociale brésilienne (masters and servants) doublée d'une chronique familiale (où dès qu'on devient un peu moins riche, les choses vont beaucoup moins bien), centrée autour d'un personnage d'ado pas du tout représentatif des "héros" brésiliens "habituels" (il est pâlichon et plutôt grassouillet, ce qui le rend d'autant plus attachant). Moins esthétique que Les bruits de Recife, mais tout aussi revendicatif.
suivi de
FORT BUCHANAN
de Benjamin Crotty
***
... Un film, euh... juste improbable ? Des hommes et des femmes attendent leurs maris soldats en mission à Djibouti... Ca parle beaucoup (chiffons, parties intimes, jalousie et moyens de se consoler en l'absence des époux). Entre Le désert des tartares version pâmoison et La semaine de Suzette numéro spécial treillis. Puis on part à Djibouti rejoindre les époux, et tout ne se passe pas forcément bien... Aussi fascinant qu'agaçant (une seule copie, semble-t-il, tout du moins sur Paris) un film flottantpeut-être pas tout à fait à la hauteur de ses ambitions.
, (tous les deux au Luminor)
mardi 16 :
FIN DE PARTIE (UGC Les Halles)
de Tal Granit et Sharon Maymon
***
Une comédie noire, juive, troisième âge et hospitalière soins palliatifs et Alzheimer - ce nom ne sera d'ailleurs jamais prononcé dans le film - cela faisait tout de même une certaine accumulation de motifs de rejet... c'est effectivement très drôle et très noir au début, et puis les rires s'amenuisent ("Jusqu'à quel point peut-on encore en rire ?" il semble que les spectateurs avaient des "limites" différentes). Très bien pour commencer ce séjour. (j'aime les comédies noires juives et troisième-âge...)
MANOS SUCIAS (UGC Les Halles)
de Jozef Wladyka
***
Un film colombien au fil de l'eau, avec trois hommes dans un bateau (dont deux frères colombiens et noirs) chargés de convoyer une torpille remplie de drogue. Rien ne se passera, bien entendu, comme prévu. Ambiance virile et plutôt testostéronée (on y apprend notamment à danser le choque, qui consiste, pour le monsieur, à frotter son devant contre le derrière de la dame...), on y tue pas mal, de différentes façons, et c'est plus que plaisant à regarder (jeunes gens torse nu, ça n'est pas de ma faute...)...
LE SOUFFLE (MK2 Beaubourg)
d'Alezander Kott
****
Je ne l'avais pas prévu, mais j'ai vraiment bien fait d'y aller. Un film russe facile à exporter, parce que complètement muet (et donc sans sous-titres) et aussi magnifiquement filmé. Un père, sa fille, leur maison et leur camion, au milieu de la steppe. Deux prétendants d'ethnies différentes qui jouent au combat de cerfs, puis des militaires, des compteurs-geiger, et, in fine, l'explication du titre... Un film beau comme tout, dans la veine documentaire/poétique/romancée du cinéma kazakho-géorgien (la veine Oshashvili, ma préférée...)
LA BELLE PROMISE (MK2 Beaubourg)
de Suha Arnaf
***
Un autre israélien, un film de femme(s), presque une relecture yiddish de Cendrillon (la belle jeune fille dans la maison de la marâtre et de ses deux soeurs.) On tente de l'éduquer, de lui donner des manières, avant d'essayer de la refourguer lors de plusieurs mariages arrangés. Atmosphère étouffante (à l'intérieur) et compassée (à l'extérieur) car ces dames font partie du dernier bastion des bons catholiques friqués de la ville... Dominique m'avait prévenu qu'il valait mieux y aller un jour où on était de très bonne humeur. En effet.
(avec passages Canopée, puis à midi pause à St Michel pour le traditionnel sandwich basque en terrasse -en plus j'ai deux peintres alternativement sur leur échelle à à peine 1m de mes yeux, mais je réussis à ne pas sortir mon appareil-photo- je me perds ensuite en cherchant la rue Daubenton (et le métro Censier-Daubenton) et le cinéma La Clé, pour réaliser en y arrivant enfin que ce n'était pas du tout le film que je voulais voir (je me suis mélangé dns les titres et les résumés) et je repars donc voir si j'ai encore le temps et la possiblité de faire quelques photos aux halles - bien m'en a pris, 16h c'est une très bonne heure...-) et du coup je finis au MK2 Beaubourg
mercredi 17 :
une journée "tout UGC" (à part une pointe sur le coup de 13h jusqu'à la boulangerie du Marais où il y a des très bons sandwichs (et des jolis vendeurs, qui changent souvent)
VALLEY OF LOVE
de Guillaume Nicloux
*****
Celui-là je l'attendais espérément (encore plus fort que désespé) et j'y ai donc couru dès la séance de 9h (ce qui m'a rapporté le pressbook qui y était distribué). La bande-annonce m'avait donné très envie (la très belle musique y est de Charles Ives). Si, comme espéré Huppert y est Huppertissime, Depardieu, lui, est gigantesque. dans tous les sens. Autant elle joue peut-être un peu sur (ou dé : surjoue, déjoue, vous suivez ?) autant lui impressionne d'autant plus qu'il se cantonne dans un registre infra, ou quasi.. Isabelle, Gérard, le désert, le fils mort. Les lettres, l'amour... J'y ai pleuré à plusieurs reprises. J'y retournerai. Top 10, sans doute.
MUSTANG
de Deniz Ganze Ergüven
****
C'était le jour des sorties, et, dans l'ordre, ce film-là était le deuxième. Des jeunes filles turques subissent d'abord, puis tentent de se rebeller contre, l'oppression "habituelle" des femmes dans les civilisations moyen-orientales. Frangines sequestrées dans leur maison, comme une version turkish de Virgin suicides, (même si, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des suicides, si tant est qu'être mariée de force à un homme qu'on ne connaît pas n'en soit pas un...) parce qu'elles se sont "frottées contre la nuque des garçon", ensevelies sous le poids des traditions (promulguées par les hommes et entretenues par les vieilles) et cherchant, littéralement, à s'en sortir. C'est la plus jeune des soeurs qui est la narratrice (et il faut redire combien elles sont toutes mimi).
L'ECHAPPEE BELLE
d'Emilie Cherpitel
***
Celui-là c'est la bande-annonce, vue la veille, qui m'a tenté, où Clothilde Hesme, en couleurs et à cheveux courts, donne la réplique à un gamin, Léon (avec une bonne bouille et un belle justesse), qui s'est sauvé une fois de plus de l'orphelinat, et vient chercher refuge auptès d'elle. Un film léger et joli comme un papillon. (avec, en plus, une chanson de The National dans la BO...) J'ai un peu dormi au milieu et le générique final m'a appris que j'avais (heureusement ?) loupé F. Beigbeder (...) Et, au générique de fin une très jolie jolie version de Bella ciao à deux voies (la demoiselle et l'enfant). Sans compter que Clothilde H. a vraiment des yeux admirables.
L'EVEIL D'EDOARDO
de Duccio Chiarini
****
L'autre excellente surprise du jour, un film rital délicieux, autour d'un ado qui, un été avec son pote, a désespérément envie de baiser et cherche donc à approcher des jeunes filles dans ce but. Dialogues crus (j'adore), et un problème qu'on n'aborde pas souvent dans ce genre de teen-movie ritalo-estival : le jeune homme souffre d'un phimosis, et hésite à se faire opérer... On y apprend, que, à l'italienne, faute de demoiselles disponibles, on peut se consoler en baisant avec... un poulpe (tout frais pêché)! Succès garanti en société. N'est-ce pas un peu trop pour public averti pour figurer dans notre prochaine semaine italienne ?
jeudi 18:
LA REVELATION D'ELA
de Äsli Ozge
***
... Qu'il est loin le temps où les films turcs diffusés en France ne parlaient de pauvres paysans avec leurs chèvres ou de gamins dépenaillés, songeais-je devant ce très contemporain portrait d'un couple vivant dans un super appart de la mort design qui tue et tout, où elle est artiste contemporaine et lui architecte. Couple qui bat un peu de l'aile (ça commence par une scène de rapport conjugal assez chaude, avec un joli papa plein de poils et de barbe, et une maman avec des seins et des tatouages -sur les hanches- visibles) et ça ne va pas aller en s'améliorant, tout ça parce qu'elle a peut-être surpris un appel de son mari à une créature (on n'en sera jamais sûr).C'est bien mais c'est vraiment très froid. (Et le turc est vraiment une langue que j'adore entendre, à défaut de la comprendre)
LA BATAILLE DE LA MONTAGNE DU TIGRE
de Tsui Hark
***
Je n'avais jamais vu de film de Tsui Hark et celui-là passait justement dans la bonne salle et au bon moment, et donc, j'y suis allé... Il me semblait que cela avait un certain rapport avec la violence, sans que je sache vraiment à l'avance s'il s'agissait de film de sabre, de kung-fu ou de yakuza... Bon, violent, ça l'est, incontestablement, mais c'est aussi visiblement très très bien fait, le récit de cette "bataille" est inséré comme une vignette "en costumes" dans un film ultra-contemporain. La scène d'attaque du village, (où 30 gentils viennent à bout de 250 méchants sur 300) vire quand même presque un peu longuette, malgré le chiadage des effets spéciaux, les giclures de sang au ralenti, et autres graphicisations de la violence. Ca m'a quand même un peu saoulé, à la fin, et du coup (! c'est le cas de le dire) je ne suis rien allé voir d'autre, après.
vendredi 19 :
Malou a prévenu qu'elle serait là à midi, avec du boudin du Perche (de Longny, médaille d'or, même!), je vais donc voir à 9h
LES CONTES ITALIENS
de Paolo et Vittorio Taviani
**
Quelle déception! Autant j'avais adoré leur précédent César doit mourir, autant cette adpatation du Décaméron de Boccace me semble pénible et interminable (le film fait 1h55, j'ai l'impression qu'il en dure 4!). Une stylisation moyen-âgeuse pour des récits pas très intéressants (peut-être celui de l'abbesse est-il à peine plus palpitant, juste sans doute, je me connais, parce qu'on y entrevoit deux messieurs tout nus) dans une mise en scène paresseuse et anecdotique (Qui aime bien...).
Puis retour à l'appart, je retrouve Malou et alissa, et nous dégustons ce sublime boudin avec des pommes.
Puis début d'après-midi scrabble (j'adore jouer au scrabble avec Malou) suivi d'une soirée scrabble (entre les deux je serai retourné à St michel et aux Halles pour tenter -désespérément- de trouver un petit cadeau pour Elizabeth, en vain)
samedi 20 :
Mon train partant à 13h, j'ai le temps d'aller voir un film à la séance de 9h. j'emmène Malou à l'UGC Les Halles pour (re)voir
VALLEY OF LOVE
de Guillaume Nicloux
*****
qui me bouleverse autant (peut-être même plus) qu'à la première vision. (j'ai entretemps commandé un disque de Charles Ives avec le morceau Question without answer, qui est le "thème" du film, et constitue une certaine part de l'émotion que celui-ci me provoque. j'adore le début, lorsqu'Huppert est filmée de dos un long moment, puis de face mais à contre-jour, puis dans un couloir sombre, et finalement derrière le double écran d'une fenêtre et de ses lunettes de soleil, qu'elle finit par enlever. La scène dans le canyon me submerge littéralement d'émotion. Et le plan final sur Huppert, immobile sur son banc comme une statue, aussi.
























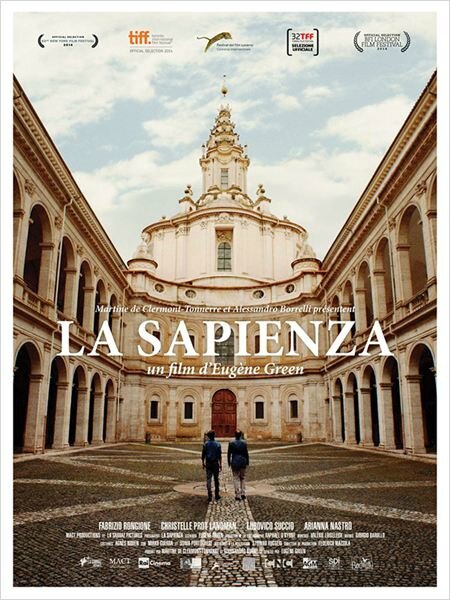
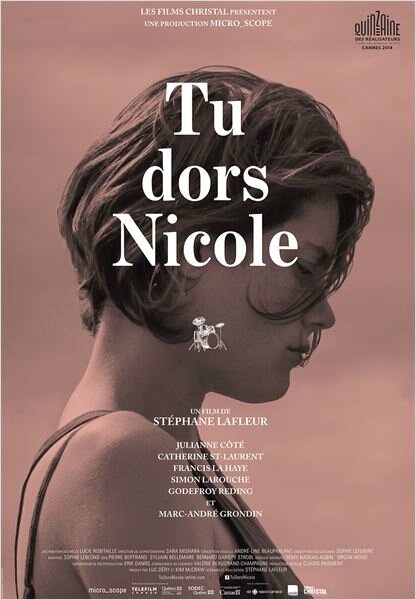










/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)