de quoi on parlait quand on parlait d'amour
BIRDMAN
d'Alejandro Iñarritu
Si Marie ne m'avait pas filé sa carte de ciné avec une place à utiliser le jour-même, je n'y serai peut-être pas allé. Je n'en avais pas plus envie que ça (il est arrivé qu'Iñarritu m'agace, l'affiche est très laide, les films à oscars bof, et surtout Michael Keaton en slip -c'est l'extrait que j'en avais vu-, bof-bof). Donc, merci à Marie, parce que j'y ai passé vraiment un sacré bon moment...
Au début, ça démarre comme une espèce de comète, de feu de bengale, de paroles, d'allées et venues dans un théâtre, et le sentiment que quelque chose me mettait un peu mal à l'aise, presque m'oppressait. Et j'ai fini par mettre le doigt dessus : il n'y avait aucun changement de plan visible, tout s'enchaînait, tac tac tac, sans aucune rupture (ni, donc, aucune respiration, et c'est ça qui me gênait, ce besoin d'oxygène. Si Hitchcock avait déjà fait ça pour La Corde, l'effet produit n'était pas du tout le même, on n'avait pas la sensation d'un film en apnée, asphyxiant quasi, tellement c'était plan-plan chez Hitch alors que là c'est quasiment cocaïné (survitaminé, en tout cas).
On a donc Michael Keaton, ex star de cinéma (il a tourné 3 films sous le déguisement de Birdman, et a refusé le quatrième), qui tente de (se) remonter sur les planches, à Broadway, en mettant en scène l'adaptation d'une nouvelle de Raymond Carver On prend le train en route, juste la veille de la première générale (visiblement, à Broadway, il y a toute une série de générales publiques avant la première) avant qu'un projecteur ne casse la tête d'un des quatre acteurs de la pièce, qui va être remplacé au pied levé par le copain (Edward Norton) d'une des actrices (Naomi Watts), un mec assez imbuvable qui va mettre assez vite le bazar dans cette ambiance déjà assez survoltée avant qu'il n'y intervienne. Tout le monde est -plus ou moins- énervé, et le fait donc savoir à Michael K -ses acteurs, donc, mais aussi sa fille, son ex-femme, sa nouvelle copine -qui lui annonce qu'elle est enceinte- Il y en a un qui reste zen, son avocat (Zach Galifianakis, en Jiminy Crickett barbu à lunettes et à poil doux, magnifique de sobriété), contrebalancé (la dualité ange/démon) par la voix qu'il entend régulièrement (et qu'il est le seul à), celle de Birdman, le personnage qu'il a autrefois glorieusement incarné, et qui vient lui donner des conseils, -un peu comme le chat dans The voices si vous voyez ce que je veux dire-.
J'aime les films qui parlent de théâtre (il y en a plein que j'adore, Vanya 42 ème rue, La fausse suivante, To be or not to be, par exemple) et j'aime aussi les films qui parlent de cinéma, tout autant. Birdman fait les deux, même s'il parle du théâtre plus frontalement que du cinéma. C'est en apparence un film sur le théâtre, mais c'est aussi -et plus profondément- un film sur le cinéma. (Broadway versus Hollywood), sur le star-system, sur les studios, sur les films de super-héros, sur la fugacité de la "gloire", et l'utilité -désormais indispensable, l'indispensabilité, donc- des réseaux sociaux, aujourd'hui.
Le choix des comédiens est plus que judicieux (Keaton avec derrière lui l'ombre de ses deux Batman, Norton avec sa réputation d'artiste duel, Naomi Watts en écho à Mulholland Drive -et dont j'apprend, par wikipedia, qu'Edward Norton est effectivement un de ses ex, (pardon pour les autres actrices dont je ne connais pas le nom), et... j'en remets une louche, Zach Galifianakis, plus que parfait dans le naturel et la simplicité).
On suit donc, dans le bruit et la fureur, Michael Keaton au centre et son cortège autour (pour parler cosmogonie, on aurait le soleil, peut-être un peu vieilli et refroidi, et son staff de planètes, comètes et satellites, se préparant à briller de tous leurs feux pour le jour de la première) bim bam, les couloirs, les coulisses, la scène, re-les couloirs, hop! sur le toit, paf! on redescend, zou! on remonte, whizzz! on entre et on ressort, sans que le réalisateur ne nous laisse le temps de reprendre notre souffle (et j'avoue que j'étais tellement obnubilé par cette idée de plan-séquence que je me suis mis à surveiller de plus en plus attentivement l'apparition des fameuses coutures (il n'a pas pu tourner deux heures comme ça d'un seul coup sans reprendre sa respiration! (Sokourov est assez secoué pour l'avoir fait dans L'arche russe, mais il y avait une continuité, logique, topologique qui justifiait "le" long travelling qui constitue le film), ou, tout du moins, les respirations, les "appels d'air". On peut en trouver deux, simples et très visibles (les plans sur le ciel avec le passage du jour à la nuit, et vice-versa) et une troisième, (avec un plan de couloir vide, où finit par apparaître, me semble-t-il, Michael Keaton)... mais à la fin j'étais beaucoup trop pris par ce qui se passe -se joue- sur l'écran pour penser encore à disséquer la façon dont c'était fait. Après un petit passage à vide (disons, dans le cas présent, une légère baisse de tension et d'énervement) au milieu, un genre de léger sur-place, le film repart très fort, très très fort, de plus en plus haut, vous empoigne et ne vous lâche plus.
Iñarritu, ici, m'a, pour une fois, pleinement convaincu. C'est noir, c'est acide, c'est tendu, ça s'agite, ça lévite, ça gravite, ça virevolte, ça survolte, ça palabre, ça se cabre, ça tourne, ça entourne, c'est un peu comme le manège à la fin de L'inconnu du Nord-express, qui devient brindezingue et se met à tourner de plus en plus vite... on se cramponne, comme les gamins, on est en même temps étourdi et émerveillé, et on en redemande...
Quand ça ralentit et que ça finit par s'arrêter, on descend, on a les jambes un peu en coton, un peu la tête qui tourne, mais avec un sourire grand comme ça... Ca c'est de l'attraction!



en voilà 3 différentes, ils ont choisi la plus moche, me semble-t-il...










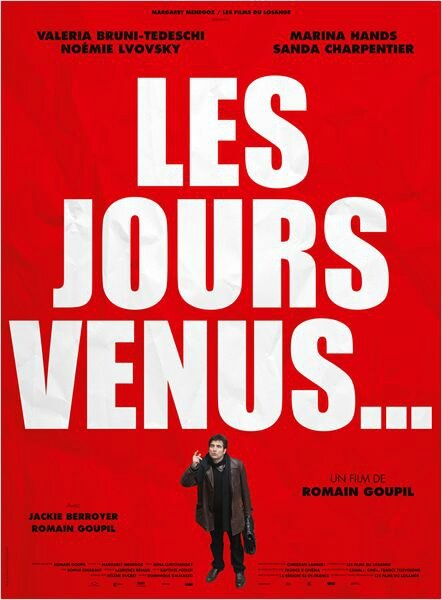


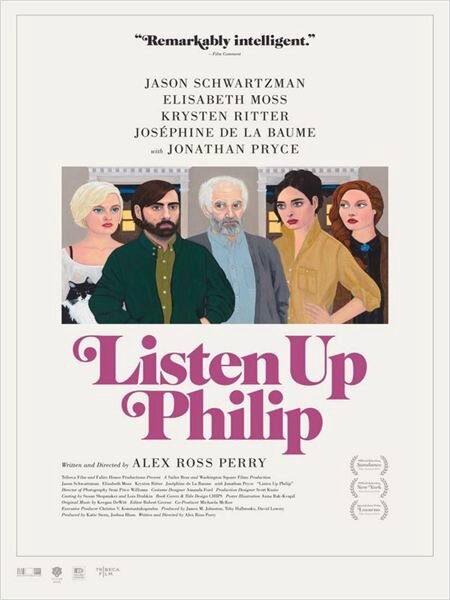




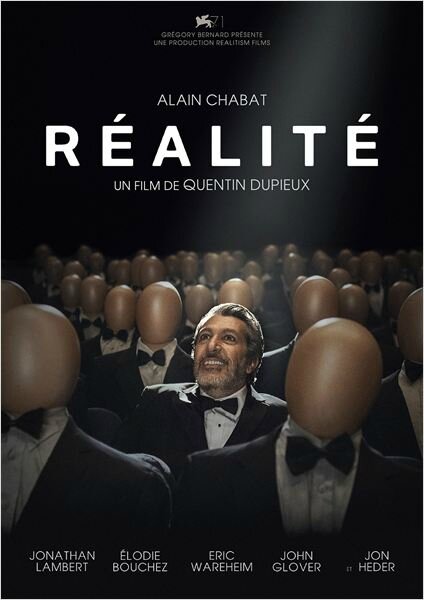
/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)