MOSCOW, BELGIUM
de Chris Van Rompaey
Une "comédie sociale flamande", hmmm... voilà un intitulé a priori pas très... titillant, et pourtant, et pourtant! C'est la première fois je crois que je voyais un film en cette langue-là et je dois dire que j'ai été plutôt séduit.
Un film qui commence au piano (j'ai toujours eu un faible pour ces musiquettes au piano solo mélancolique, aussitôt je sentirais presque la larmichette poindre) se poursuit à l'accordéon (re-je ne sais pas pourquoi, mais c'est un instrument qui m'émeut) pour se terminer en fanfare. Une dame fait les courses, cheveux défaits et l'air morose, avec deux de ses enfants, dans un supermarché (avec le piano qui musiquette mélancoliquement, donc) lorsque, sur le parking dudit supermarché, en faisant marche arrière, elle va heurter le parce-choc d'un gros camion jaune. Aïe! La dame dans la voiture, c'est Matty, la quarantaine, deux enfants, attendant un mari parti avec une petite jeune depuis bientôt six mois et ne sachant pas bien s'il va réintégrer ou non le domicile conjugal, et le monsieur dans le camion c'est Johnny, un hurluberlu barbu rouquin, dix ans de moins, dont la femme (il a son prénom tatoué sur le torse dans un coeur forever) s'est barrée avec son avocat et qui en a conçu une certaine amertume. Entre les deux, ça commence donc plutôt forte, sur les chapeaux de roue : vociférations, insultes, constat pas du tout à l'amiable et autres gracieusetés.
Et puis voilà que...
Il la rappelle, elle raccroche. Il vient chez elle pour lui réparer son coffre gratos (mais à mon avis pas que pour). Elle refuse d'abord, puis finit par l'inviter à manger (ce jour-là, c'est du boudin. On aura ainsi dans le film plusieurs scènes de repas, chacues plus ou moins bouffonnes, autour d'un plat typique -car Matty est une bonne cuisinière- boudin, carbonade, waterzooi... car le film est construit comme un calendrier, où les dimanches -et donc les repas dits dominicaux- donnent le rythme) et, de fil en aiguille, ils iront prendre un verre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison avec son t-shirt à l'envers, sous l'oeil désapprobateur de son aînée (une ado rebelle, avec des faux airs de Cate Blanchett) qui ne voit pas cette histoire d'un -justement- très bon oeil (mais qu'elle a plutôt joli, d'ailleurs.)
Matty est perplexe : elle attend / elle espère le retour de son mari, elle cède à Johnny en se disant que c'est une aventure sans lendemain, un coup d'un soir, mais hésite à le croire lorsqu'il lui dit qu'il l'aime, bref elle ne sait plus quoi faire. La situation se complique encore lorsque son mari -un bellâtre bien intentionné- lui fait part des antécédents juridiques de Johnny et de ses différents conjugaux (soutenu par l'adolescente) et tout devient soudain très compliqué. Souvent femme varie... Elle va semettre à osciler, entre les deux mon coeur balance, entre folie et raison, entre popote et aventure, sans réussir à prendre une décision. Rajoutez à tout ça une paire de chaussures italiennes un peu trop petites, un fût de bière dans un pare-brise, deux assiettes de waterzooi renversées, un karaoké un peu embarrassant, et vogue la galère...
(Comme on est dans une comédie sociale, on sait -on espère- que l'amour le vrai finira par triompher, hein, on ne se refait pas, midinet on est né, midinet on reste...et, euh, on ne sera pas déçu ?) Le film a, dans tous les sens du terme, une bien jolie musique. Les dialogues sont affûtés (on rit au moins autant que l'on est attendri.) Et les deux interprètes principaux sont extrêmement attachants (j'y rajoute aussi l'ado rebelle qui réussira à surprendre tout son monde lors de la scène dite "du waterzooi"). Et puis, personnellement, j'ai toujours une certaine tendresse pour les cabines de bahut, vues de l'intérieur -surtout si le routier est assis à poil au volant, je n'invente rien même si c'est très fugace- mais ceci n'est pas vraiment un argument critique objectif, n'est-il pas ?)
Un film au diapason des plats qu'il évoque : une cuisine rustique, solide, des recettes ayant fait leurs preuves, (ne tablant donc pas sur l'originalité), aguerries, mais élaborées par un chef avec son coup de patte personnel, utilisant des ingrédients suffisamment goûteux, et les épiçant assez subtilement pour réjouir le palais le plus aguerri. Avec, en prime des conseils judicieux sur l'utilisation de la moutarde.







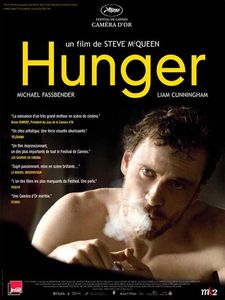









/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)