L'APPRENTI
de Samuel Collardey
En avant-première régionale (le film sort en franche-comté une semaine avant le reste du monde) et en présence du réalisateur et de deux acteurs, dans une salle (pleine quasiment!) du bôô cinéma. On avait déjà reçu le monsieur pour son court-métrage Du soleil en hiver (qu'on avait, par ici mais pas seulement, beaucoup apprécié) et voilà qu'il nous revient (le preuve qu'il a de la suite dans les idées) avec son premier long-métrage, distingué par le prix de la semaine de la critique à Venise (pour une première participation, on pourrait rêver pire), qui raconte la même histoire : les relations entre un jeune en formation (à tous les sens du terme) et son maître de stage, un paysan du Haut-Doubs.
Un film entier (comme on dirait fromage au lait entier, pour filer la métaphore laitière), mais plutôt rayon "au lait cru" que "pasteurisé". On est là, une nouvelle fois, à faire le grand écart (hihi j'avais écrit grand écran) entre le documentaire et la fiction : les acteurs jouent tous leur propre rôle, portent leur vrai prénom, habitent leur vraie maison, le tournage suit chronologiquement l'année de stage en alternance de Mathieu, (de septembre à juin), chaque scène est saisie dans une prise unique, mais est-ce bien pour autant du vrai réel pris sur le vif ? Samuel Collardey explique qu'il n'a jamais voulu voler aucune image, au contraire, il en revendique le statut cinématographique : débarquant avec sa grosse caméra, ses projos et tutti quanti, il apportait à chaque fois à ses acteurs une situation qu'il leur proposait de jouer (ou rejouer) en impro, en fonction de ce qui avait été filmé la fois précédente. Et il laissait la caméra tourner jusqu'au bout. En reconnaissant que ce mode de tournage n'aboutissait pas toujours à une "bonne" scène, et acceptant sa responsabilité dans ce choix ("ce n'était pas le bon moment", "ce n'était pas une situation adaptée", etc.)
Et tout ça donne un sacré film. Qui a fait jubiler des critiques qui ont situé le réalisateur comme un rejeton du couple Pialat/Depardon (huhu l'idée du couple me fait sourire). A mon sens, s'il a bien l'acuité documentaire et le sens du cadrage d'un Depardon, Collardey a surtout de Pialat la rigueur du constat social, l'observation méticuleuse et en gros plan des relations humaines, sans en avoir (heureusement) conservé l'âpreté (l'amertume ? le nihilisme ?).
Des engueulades, il y en a, et des prises de bec et des remontages de bretelles, mais il y a surtout le reste (la vie) : l'apprentissage du métier (rentrer les vaches, ça n'est pas si facile que ça en a l'air), la vie à l'internat, les soirées avec les potes (à aligner les bières et à parler cul et teubs), les premiers émois amoureux (car c'est bien d'apprentissages(s) qu'il est question), du chat internet au premier baiser, certaines retrouvailles et certaines confessions (prononcées ou écoutées), sans oublier de sacrées parties de rigolade.
Le film est complètement dans l'instant, dans la captation immédiate (d'une situation, d'un paysage -ah ces panoramiques noyés de brume...-, d'un échange, ou même d'un silence) plutôt que dans l'élaboration d'une intrigue, et jamais cette succession de scènes parfois montées très cut n'apparaît comme une juxtaposition gratuite (artificielle) de vignettes folkloriques. Bien au contraire. Car au fil de ces instants (derrière chacun d'eux ?) on sent que quelque chose se crée, s'élabore, se met en place, que ce soit au niveau de "l'architecture interne" de Mathieu ou des interactions entre lui et Paul. Sans que rien ne doit vraiment précisé, défini. (Pourtant Collardey avait au départ écrit un scénario, qu'il a dès le début du tournage complètement abandonné), ce que d'aucuns lui ont d'ailleurs reproché, et dont il est d'ailleurs conscient, ayant regretté lors de la discussion d'avoir peut-être été trop timide avec la fiction. La question la plus cruciale étant "Mathieu aura-t-il son BEP ?", autant dire que le spectateur n'est pas vraiment torturé par le suspense ou l'attente du dénouement. Le plaisir est ailleurs.
Pourtant, à bien écouter le réalisateur, ce qui se joue sur l'écran n'est pas tout à fait du vrai vrai, puisqu'il reconnaît avoir suggéré (provoqué, induit) les éléments-clés de certaines scènes (les remontrances de la femme de Paul en épluchant les pommes, l'apprentissage de la chanson à la guitare, le chant dans l'étable, etc.) Là où Claire Simon faisait du faux à partir du vrai (en faisant rejouer par des actrices des entretiens qui avaient vraiment eu lieu), Samuel Collardey adopterait peut-être le dispositif inverse : faire du vrai à partir du (peut-être un peu) faux ? Mais tout ça reste théorique, et on s'en fiche, au fond, parce que tout ça est simplement passionnant.
Malgré ses maladresses, malgré les faiblesses que certains lui reprochent, on ne peut que se réjouir, se dire que les bonnes fées du 7ème art se sont penchées sur le berceau de ce nouveau venu (hmm si c'est pas du lieu commun et du cliché, ça...) Allez, Samuel, au boulot!









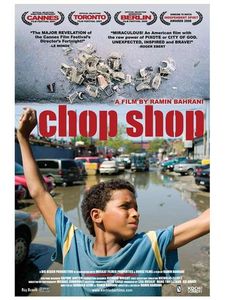


/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)