de la semaine
EVERY THING WILL BE FINE
de Wim Wenders
LE DOS ROUGE
d'Antoine Barraud
Les deux films qu'on programmait cette semaine dans le bôô cinéma. Deux films diamétralement opposés, l'un d'un réalisateur chevronné (comme on pourrait le dire d'une maison, avec des poutres et des chevrons), d'un réalisateur qu'on connait depuis quarante ans, qu'on a beaucoup adoré au début, et dont on s'est progressivement éloigné au fil des années, et l'autre d'un réalisateur parfaitement inconnu au bataillon, et à propos duquel on ne pouvait donc avoir le moindre avis.
Un film qui raconte l'histoire d'un écrivain, et l'autre celle d'un cinéaste. Le premier ne l'est pas vraiment -écrivain- (il est incarné par James Franco, dont je ne suis pas persuadé qu'il soit un immense acteur, et que je préfère lorsqu'il fait l'idiot cul nu dans les champs avec son pote Seth Rogen) le second l'est vraiment -cinéaste- puisqu'il s'agit de Bertrand Bonello, dans son propre rôle, ou presque, et qui ne l'est pas "vraiment", acteur. (Au jeu des comparaisons, si on met côte à côte James Franco et son jeu minimaliste (mais bien peigné) et de l'autre Bertrand Bonnello, avec sa petite tête de poussin dépeigné, il n'y a pas photo, c'est vers B.B que penche notre coeur).
Dans le premier film il y a aussi Charlotte Gainsbourg qui toujours me touche, (mais que je trouve ici plutôt singulièrement sous-employée) et dans le second Jeanne Balibar que j'adore tout autant (mais qui disparaît beaucoup trop vite à mon goût, dans un genre de clin d'oeil à Cet oscur objet du désir, si je ne m'abuse). Si Charlotte chuchote, Jeanne, elle, vocalise et roucoule et se la joue, nous la joue, d'assez grandiose façon. Balibarissime, comme dirait Hervé.
Le film de Wenders fait un peu moins de deux heures, celui de Barraud un peu plus (de deux heures), et pourtant le premier, en "temps subjectif" semble durer beaucoup plus longtemps que l'autre. Je l'ai trouvé (le film de WW) très mou, académique et sententieux, tandis que celui de Barraud semble toujours sur la brèche, fureteur, inventif (furetif, inventeur), alerte (même s'il semble de temps en temps un peu trop approximatif, mais c'est toujours mieux de tenter, d'expérimenter, que de rester assis sur ses certitudes, non ?).
Dans les deux films la musique a une grande importance. Celle de Wenders est signée Alexandre Desplats (j'ai envie d'écrire "comme un film sur deux désormais"), et, s'il lui arrive parfois d'être sublime (cf celle du générique de fin), on est en droit de la trouver un peu trop omniprésente, asphyxiante, même, parfois. Un beau cadrage, une ample louchée de musique là-dessus, et hop, on se regarde filmer... (tandis que, spectateur, un peu on s'assoupit, zzz...) Chez Barraud, elle est... différente, intriguante, énervante parfois, chatoyante, sautillante (ça dépend des fois) et on s'aperçoit au générique de fin qu'elle est quasi-intégralement signée par... Bertrand Bonnello. et, en parlant de musique, on a en prime celle de la voix-off, follement classe, de Charlotte Rampling.
Un autre signe qui ne trompe pas : je suis à peu près sûr que j'achèterai le dvd du Dos rouge (si un jour il existe!) et que je reverrai le film si je peux, tandis que Every thing... mouais, bof. Ce qui est dommage, dans le film de Wenders c'est qu'il est désespérément lisse : poli, astiqué, sans rien qui dépasse. Rien qui accroche, rien à quoi se raccrocher. C'est magnifiquement filmé (soyons honnête, quand même) mais c'est hélas un peu sans âme, et il faut attendre les dernières scènes (avec le fils de Charlotte) pour que surgisse enfin une belle émotion véritable.
On pourra arguer que Wenders est sérieux (que son sujet est sérieux) et que Barraud pas (forcément), et que ce n'est pas malin de vouloir comparer des choses si différentes : sérieux / pas sérieux. Mais j'ai démarré ce post sur les deux, et je suis bien obligé de le continuer ainsi, à cloche-pied.
Tandis que Barraud crapahute sur des chemins de traverse, nous promène dans divers musées parisiens, nous syndrôme de Stendhalise, cherchant l'objet nodal de son propre film avec le même entêtement que met Bertrand B. à trouver le sujet du sien. (la notion de monstre) Wenders nous déplie les jolis paysages du Canada (le début, dans la neige, est splendide) à différentes saisons, en étiqutant bien ses sauts temporels (deux ans plus tard, quatre ans plus tard...). Le dos rouge, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui fait du bien, les strates temporelles comme les sautes d'humeur, ou les baisses d'énergie, les chansons qui fleurissent tout à coup, le sentiment de work in progress, bref l'énergie étrange (et l'étrangeté énergique, parfois) qui nous fait tendre la main pour nous accrocher au cul du véhicule qui taille la route et courir derrière malgré les cahots.
Avec Barraud, on se sent sollicité, titillé, chatouillé, en tant que spectateur, avec Wenders, hélas, on reste juste en position de. (Wim, Wim, nous nous sommes tant aimés, pourtant...)






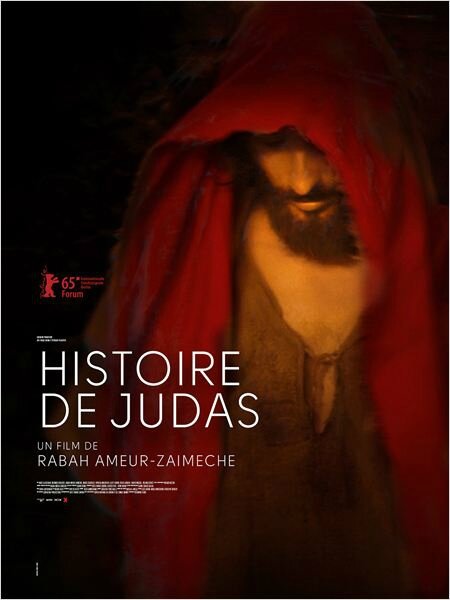







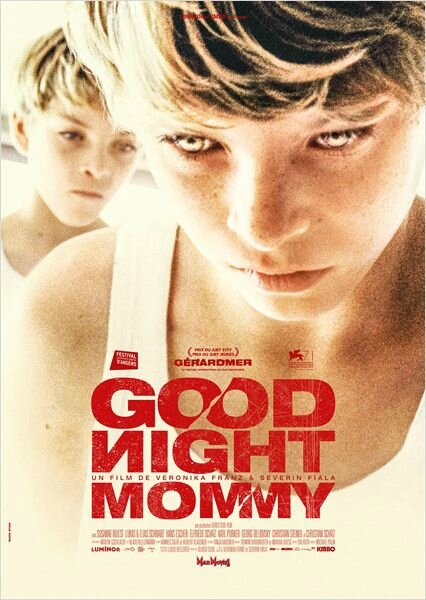








/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)
/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)